Chloé Ridel : « Face au mépris du Président, il ne faut pas baisser la tête ! »


La décision du Conseil constitutionnel, publiée vendredi 14 avril, suivie de la promulgation express de la réforme des retraites par Emmanuel Macron, marque-t-elle la fin de la contestation ? Pas du tout, répond Chloé Ridel, co-fondatrice de Mieux Voter – une association qui promeut le jugement majoritaire –, porte-parole du Parti socialiste et ex-directrice adjointe de l’Institut Rousseau, laboratoire d’idées attaché à la reconstruction écologique et démocratique de nos sociétés.
Mais, désormais, la question de la défense des principes démocratiques et des droits du Parlement face à un pouvoir en dérive autoritaire vient se joindre à la protestation sociale.
Le Conseil constitutionnel vient d’avaliser l’essentiel de la réforme des retraites, et de rejeter la demande de référendum d’initiative partagée. Dans ces deux décisions, qu’est-ce qui vous semble le plus important ?
Chloé Ridel : Ce que j’observe d’abord, c’est que le gouvernement se sert de la décision du Conseil constitutionnel pour tenter de légitimer sa réforme et de dire « on passe à autre chose ». Pourtant le Conseil ne s’est jamais prononcé sur la légitimité de la réforme mais sur sa constitutionnalité ; il ne faut pas confondre les deux choses.
Or nous assistons à la tentative du gouvernement d’assimiler ceux qui veulent continuer la mobilisation à la contestation des institutions. Cela n’a rien à voir. Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, disait : « toute loi anticonstitutionnelle est forcément mauvaise, mais une loi mauvaise n’est pas forcément anticonstitutionnelle ».
Ensuite, sur le fond de la décision, des constitutionnalistes comme Dominique Rousseau, estiment que la décision est contestable par certains aspects, car le conseil contribue à approfondir le parlementarisme rationnalisé, c’est-à-dire à renforcer l’exécutif.
Le Conseil constate ainsi un cumul « inhabituel » d’outils (article 47.1, et 49.3, 34.1 de la Constitution, article 46 du règlement du Sénat…), mais pourtant cela ne serait pas inconstitutionnel. Quant à la clarté et la sincérité des débats, notamment sur les pensions minimales à 1 200 euros, le Conseil affirme qu’elles ne sont pas entachées, malgré la transmission d’informations erronées de la part du gouvernement.
Néanmoins, cette décision ne disant rien de la légitimité de cette réforme, le Président aurait pu utiliser l’article 10 de la Constitution pour demander une deuxième délibération au Parlement, en mettant par exemple l’article 7 au vote. Cela aurait pu avoir un effet politique. Au contraire, il a choisi de promulguer le texte dans les heures qui ont suivi la décision.
Le Conseil a rejeté la proposition de référendum d’initiative partagée (RIP) avec des arguments juridiques assez ténus : il ne s’agirait pas d’une « réforme ». Ce rejet du RIP enterre-t-il définitivement cet instrument, qui devait permettre l’expression du peuple ?
C. R. : L’éventualité du référendum d’initiative partagée reste ouverte, puisque le conseil doit encore examiner une deuxième demande de RIP présentée par les parlementaires de gauche, et dont on saura le 3 mai s’il est accepté.
C’est évidemment un outil difficile à saisir. Il faudrait 4,9 millions de signatures, dans des conditions compliquées, sans compter les multiples obstacles avant, pendant et après la campagne de signatures. On peut quand même observer le précédent d’ADP (anciennement Aéroports de Paris, ndlr), dont la privatisation a été annulée alors que 1,1 million de signatures seulement avaient été réunies pour s’y opposer.
Cela démontre que la perspective du RIP peut à elle seule indiquer la voie de la sagesse aux gouvernants. Il faut donc persister à s’en saisir. La mobilisation va continuer quoiqu’il en soit, avec la mobilisation sociale d’abord, avec un appel de l’intersyndicale à manifester le 1er mai, ou au plan législatif avec le dépôt d’une proposition de loi d’abrogation de l’article 7 par les élus du Parti socialiste.
Mais après trois mois de grèves, de journées nationales de manifestations, de contestation parlementaire pour le moment sans résultat, n’est-il pas temps pour les forces opposées à la réforme, tant politiques que syndicales, de s’interroger sur l’efficacité de leurs actions ?
C. R. : On peut s’interroger sur nos responsabilités, mais nous avons quand même assisté à un niveau inédit de mobilisation, de manifestations dans le calme pour la plupart du temps. La responsabilité est donc d’abord du côté du gouvernement, totalement sourd, voire méprisant vis-à-vis des gens qui se sont mobilisés, ont fait grève, ont perdu des revenus. Le comportement d’Emmanuel Macron est irresponsable et dangereux, et reviendra en boomerang, en l’occurrence par une montée de l’ultra droite.
On sent monter du côté du pouvoir un réflexe d’ordre et autoritaire, avec des intimidations à l’encontre d’associations comme la Ligue des droits de l’Homme, avec des violences policières qui ne sont pas condamnées, ou en termes bien faibles par les membres du gouvernement, à l’égard d’une partie de la jeunesse, matraquée à l’occasion de son entrée en politique.
C’est très préoccupant, car les tentatives d’intimidation des associations qui luttent pour la défense des droits démocratiques est un des traits des démocraties illibérales. Les régimes autoritaires ont commencé souvent par la disqualification des associations, voire l’intimidation des opposants, comme on l’a vu avec Gérald Darmanin s’en prenant aux « écoterroristes ».
Aujourd’hui, on n’a plus le droit de dire que les violences policières existent sans être amalgamé à des gens qui seraient « anti-police », voire antirépublicains ! Il n’y a plus de place pour la critique raisonnée de l’action des forces de l’ordre. Cette outrance sur la forme masque l’incapacité à répondre sur le fond à la colère dans la population, mais cette polarisation extrême installée par le gouvernement est dangereuse.
Au vu de la souplesse d’interprétation dont le Conseil constitutionnel a fait preuve, ne peut-on craindre qu’il ne soit tout aussi complaisant en cas de dérive autoritaire du pouvoir ?
C. R. : J’ose espérer que non ! Mais il est vrai que ses décisions d’hier créent un précédent qui permettrait à un gouvernement futur d’utiliser tous les outils du parlementarisme rationnalisé, dans un esprit qui n’était pas celui des rédacteurs de la Constitution, dans un sens contraire aux droits du Parlement et d’une réduction de la démocratie. La République repose normalement sur l’équilibre des pouvoirs. Là, le Conseil constitutionnel a validé le passage en force de l’exécutif. C’est préoccupant.
Le mouvement de protestation doit-il en conséquence s’élargir à la défense des principes de la démocratie et des libertés publiques, et chercher à s’amalgamer d’autres forces sociales et politiques ?
C. R. : De fait, depuis l’utilisation du 49.3, nous avons basculé dans une autre dimension, celle de la crise démocratique et politique, parce que le gouvernement n’avait pas de majorité sur son texte à l’Assemblée nationale. Depuis ce jour – et c’est d’ailleurs le moment où la jeunesse est entrée dans le mouvement – la contestation ne porte plus seulement sur les retraites, mais aussi sur une certaine idée de la citoyenneté et de la démocratie.
La démocratie est notre bien à tous, et pas seulement à la gauche et la Nupes. On devrait s’attendre à ce qu’elle soit défendue par tous. Hélas, on ne peut que constater que des députés LR ont fait le choix inverse, et laissé l’exécutif piétiner les droits du Parlement. Il y a eu une forfaiture ce jour-là de la part de ces députés !
L’ultime marque du mépris de la part du Président, que représente la promulgation du texte en urgence, doit nous conduire à ne pas baisser la tête et à nous mobiliser pour notre dignité.






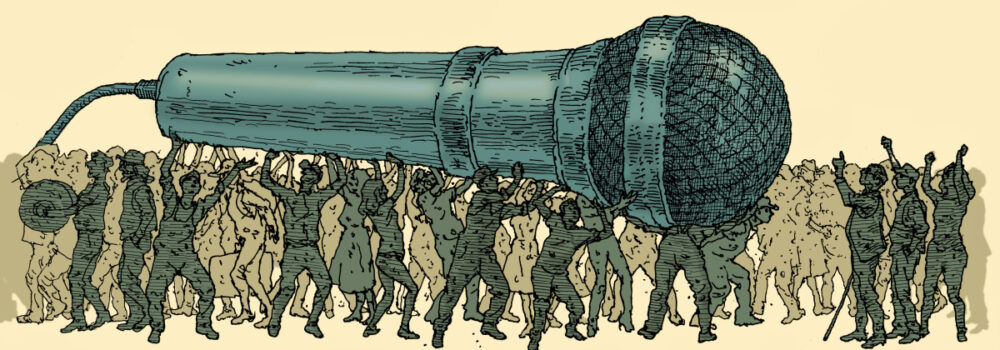





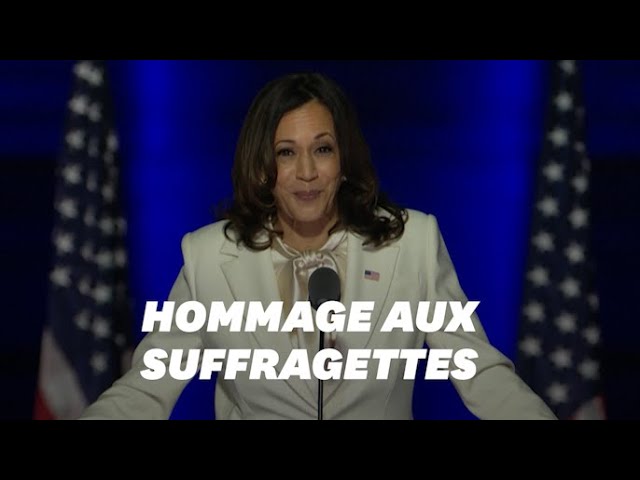


 RSS - Articles
RSS - Articles
Laisser un commentaire