« Dans les négociations, seuls les médecins les plus durs s’expriment »


Les médecins libéraux font les gros titres de l’actualité. Les conditions de travail et de prise en charge se dégradent à l’hôpital ; l’accès aux soins est inégalitaire, avec 11 % de la population sans médecin traitant, dont 650 000 patients souffrant de maladies chroniques ; la démographie médicale est orientée à la baisse : ce n’est qu’en 2036 que le nombre de généralistes rapporté à la population retrouvera son niveau actuel.
Dans ce contexte, que peut la médecine de ville ? Les négociations conventionnelles qui ont lieu tous les cinq ans devaient aboutir ce mardi 28 février. Mais elles ont surtout fait ressortir des positions antagonistes et ont abouti à un échec, comme l’a annoncé ce lundi 27 février François Braun, ministre de la Santé. Ces derniers mois, un collectif « Médecins pour demain » a demandé le doublement du prix de la consultation, de 25 à 50 euros, et les syndicats représentants les médecins libéraux ont multiplié les coups d’éclat : une grève début décembre et une autre le 14 février contre « le démantèlement de la médecine en France et la destruction du système de santé ».
Alors que les principaux syndicats réclament une consultation à 30 euros, l’Assurance maladie a proposé une revalorisation à 26,50 euros et concédé 30 euros pour les médecins acceptant des contraintes supplémentaires pour lutter contre la désertification médicale dans le cadre d’un « contrat d’engagement territorial ». L’économiste Brigitte Dormont, spécialiste des questions de santé, éclaire les ressorts de cette discussion.
Faut-il augmenter le tarif de la consultation des médecins ?
Brigitte Dormont : Le format de la convention médicale, avec un rendez-vous attendu tous les cinq ans, favorise une communication des syndicats de médecins focalisée sur le prix de la consultation. C’est en effet un des rares éléments faciles à comprendre dans le maquis tarifaire qui règle les rémunérations des médecins libéraux en France. Mais c’est loin d’être la seule source de rémunération.
Les médecins reçoivent aussi des forfaits à la capitation [du latin caput, la tête et donc l’individu, NDLR], c’est-à-dire un forfait annuel par patient, modulé selon son âge et son état de santé, et des primes liées à la qualité des soins, la ROSP, la « rémunération sur objectif de santé publique ».
Ces primes constituent une sorte d’usine à gaz que l’Assurance maladie propose d’ailleurs de simplifier, mais elles permettent de formaliser des critères de qualité de soins, par exemple en incitant les médecins à ne pas trop prescrire de médicaments pouvant favoriser les chutes chez les personnes âgées, ou en encourageant un meilleur suivi des patients diabétiques. Pour un généraliste, le cumul des forfaits et de la ROSP atteint en moyenne plusieurs dizaines de milliers d’euros par an, ce qui est loin d’être négligeable !
S’ajoutent à cela des forfaits « structure » d’un montant moyen de 70 000 euros en 2019 pour les maisons de santé pluriprofessionnelles, pour embaucher des assistants médicaux et des salariés assumant le travail administratif, ou encore pour les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui sont des réseaux de soignants en charge de la population sur un territoire.
Dans ses communiqués, le collectif réclamant la consultation à 50 euros dit que cela est nécessaire pour se décharger du travail administratif. Cet argument est fallacieux car le forfait structure existe, mais cela implique de se regrouper. Je soupçonne ce collectif de ne pas vouloir le faire, alors que c’est dans l’intérêt des patients.
Les regroupements permettent des gains d’efficience, une collaboration avec d’autres professionnels de santé et une organisation des gardes pour répondre aux urgences à toute heure. S’y opposer est un combat dépassé. Les jeunes médecins plébiscitent l’exercice en groupe : en 2022 déjà 70 % des généralistes exercent en groupe.
« En moyenne, le revenu annuel d’un généraliste dépasse 90 000 euros, alors que les généralistes sont bien moins payés que la plupart des spécialistes »
Il faut par ailleurs avoir conscience que les revenus des médecins sont très importants. En moyenne, le revenu annuel d’un généraliste dépasse 90 000 euros, alors que les généralistes sont bien moins payés que la plupart des spécialistes. Rien ne prouve qu’une augmentation du tarif de la consultation augmenterait le temps de travail des médecins.
Cela pourrait même être le contraire, comme le suggèrent des études économiques faites en France. Augmenter substantiellement le tarif de la consultation pourrait ainsi être l’erreur à ne pas commettre, alors que la raréfaction actuelle du nombre de médecins nuit déjà à la satisfaction des besoins de soins.
Enfin n’oublions pas le chiffre donné par le directeur général de l’Assurance maladie : la revendication de la consultation à 50 euros revient pour les médecins à réclamer une augmentation de leurs revenus de 100 000 euros par an !
Les médecins reçoivent-ils des subventions de l’Assurance maladie ?
B. D. : Ceux qui s’installent dans des déserts médicaux reçoivent une aide forfaitaire de 50 000 euros. Enfin, les généralistes qui sont dans le secteur 1 (sans dépassements d’honoraires) voient une partie de leurs cotisations maladie et vieillesse prises en charge par l’Assurance maladie.
Vous n’êtes donc pas favorable à une augmentation de la rémunération des généralistes ?
B. D. : Si, mais pas sous la forme d’une augmentation du tarif de la consultation. Les généralistes ont un rôle central dans le système de soins et il est important de mieux reconnaître leur profession. Mais, il faut que le paiement à l’acte prenne moins de place.
Que préconisez-vous alors ?
B. D. : Augmenter la capitation, les forfaits annuels par patient, serait une bonne chose : cela contrebalance la logique inflationniste du paiement à l’acte en limitant les consultations inutiles. Le paiement à l’acte doit toutefois garder une certaine place pour que les médecins répondent aux besoins de leurs patients même en période de pénurie.
On peut aussi le panacher avec un salaire. En fait, toutes les formes de paiement ont leurs avantages et leurs inconvénients, qui dépendent du contexte, selon qu’il y a raréfaction des médecins, ou relative abondance comme c’était le cas au cours des années 1990.
Faut-il se passer des négociations conventionnelles ?
B. D. : L’Assurance maladie finance les soins fournis par les médecins. Sans elle, beaucoup de patients auraient des problèmes d’accès aux soins et les revenus des médecins seraient sans doute menacés. C’est pourquoi la menace d’un déconventionnement agitée par certains praticiens n’est pas crédible. Mais pour qu’il y ait un financement, il faut définir des règles. C’est l’objet de la convention, qui reste indispensable. Mais avec qui et à quelle échelle ?
La conception actuelle des conventions médicales organise tous les cinq ans un rendez-vous conflictuel à cause de la visibilité qu’elle offre aux acteurs. Il y a deux problèmes majeurs à mon sens : la discussion est centralisée et elle laisse hors du jeu les professionnels de santé autres que les médecins, alors que les solutions aux difficultés d’accès reposent sur la collaboration entre professionnels de santé.
La discussion devrait être en partie décentralisée. L’Assurance maladie fixerait un cahier des charges pour garantir un traitement égal de tous les citoyens. Elle définirait des critères d’accès aux soins, en termes de délais d’attente et de respect du tarif conventionnel sans dépassement.
Ensuite, la discussion s’engagerait au niveau des bassins de santé, en prenant par exemple appui sur les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) qui se situent à un niveau infra-départemental. Localement, les professionnels de santé se mettraient autour de la table avec l’Agence régionale de santé (ARS) pour organiser la réponse aux besoins de soins.
« Le maître mot devrait être la diversification. Sur certains territoires, les centres de santé avec des médecins salariés seraient majoritaires. Sur d’autres, l’exercice libéral en groupe dominerait »
Le maître mot devrait être la diversification. Sur certains territoires, les centres de santé avec des médecins salariés seraient majoritaires, complétés par quelques médecins payés à l’acte. Sur d’autres, l’exercice libéral en groupe dominerait. Toutes les formes de paiements panachés pourraient être envisagées.
Il y aurait une obligation de résultat et une liberté de moyens pour y parvenir, de façon à tenir compte à la fois des particularités de chaque territoire, des besoins spécifiques des populations concernées, et des préférences des médecins. L’Assurance maladie devra suivre attentivement les résultats obtenus en matière de santé publique et d’égalité de traitement de tous.
L’intérêt de la diversification est d’éviter les blocages que crée inévitablement une discussion centralisée. Les médecins sont un groupe social très hétérogène. Dans la convention centralisée, seuls les plus durs s’expriment.
Les syndicats de médecins libéraux sont vent debout contre l’accès direct aux infirmières de pratique avancée (IPA), prévu dans la proposition de loi Rist actuellement en discussion. Ils agitent le spectre d’une médecine à deux vitesses, avec d’un côté le médecin pour les plus riches, et de l’autre, les IPA pour les pauvres. Cet argument est-il de bonne foi ?
B. D. : Le principe de l’IPA n’est pas qu’il ou elle remplace le médecin, mais qu’elle prenne en charge une partie de ses tâches lorsqu’une consultation médicale n’est pas nécessaire.
L’argument d’une médecine à deux vitesses est fallacieux, car l’intervention de l’IPA n’est pas liée au niveau de revenu du patient, mais à la nature de ses besoins. Curieusement, il est brandi par de nombreux défenseurs de la liberté tarifaire, alors que les dépassements d’honoraires, eux, créent vraiment un système à deux vitesses, dans lequel les plus riches ont accès aux spécialistes avec des délais plus brefs.
Faut-il remettre en cause la liberté d’installation des médecins ?
B. D. : Sauf exception, les déserts médicaux sont rarement localisés dans des régions entières ou dans des campagnes. Très souvent, il s’agit de couronnes périurbaines, où la population ne peut pas avoir de médecin traitant ni se faire soigner à proximité.
La solution n’est pas d’imposer que les médecins aillent vivre dans une ville périurbaine, mais qu’une maison de santé y soit ouverte, où les professionnels alentour travailleraient quelques jours par semaine ou par mois. Cette solution a pour avantage d’être plus juste : elle évite de faire peser sur les jeunes médecins des contraintes à l’installation et impose à toutes les générations de médecins la même responsabilité quant à la réponse aux besoins.
Quid de la permanence des soins ? Elle n’est plus obligatoire pour les médecins depuis 2002 et les urgences sont engorgées. Faut-il la rétablir ?
B. D. : Ce ne doit pas être une obligation individuelle mais une responsabilité « populationnelle » portée par les médecins concernés. Sur un territoire donné, la médecine de ville doit se coordonner pour offrir une permanence des soins le soir, la nuit et le week-end.
Les médecins exercent une profession libérale, mais ils ont une délégation de service public : ils sont payés pour assurer les services de santé auprès de la population qui cotise à l’Assurance maladie pour garantir une solidarité dans l’accès aux soins. Chacun cotise également, en fonction de ses moyens, et doit avoir un égal accès aux soins.






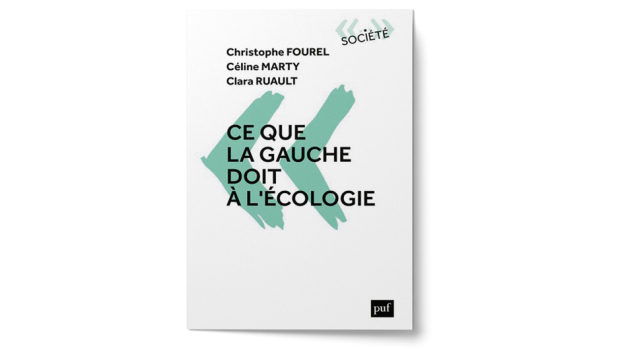





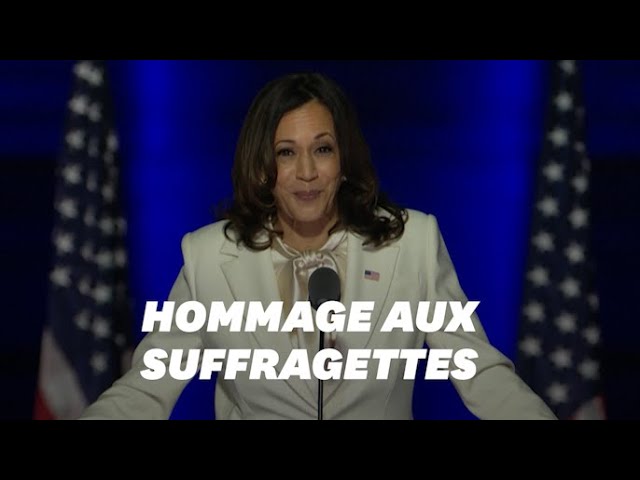


 RSS - Articles
RSS - Articles
Laisser un commentaire