Et si on commençait par changer le travail au lieu de réformer les retraites
 Des travailleuses et des travailleurs par centaines de milliers contre la retraite à 64 ans. Le vocabulaire, cher à l’ex-patronne de Lutte ouvrière Arlette Laguiller, que l’on croyait relégué aux franges de la gauche prolétarienne, reprend du service. Et de fait, il n’existe pas de meilleure expression pour désigner salariés du privé, agents du public, ouvriers, cadres et employés, jeunes et vieux actifs, venus s’exprimer, dans toute la France et souvent pour la première fois, sur leur quotidien au travail. L’immense majorité d’entre eux, sympathisants de gauche comme de droite, ne se voit tout simplement pas faire du rab, en tout cas pas dans ces conditions.
Des travailleuses et des travailleurs par centaines de milliers contre la retraite à 64 ans. Le vocabulaire, cher à l’ex-patronne de Lutte ouvrière Arlette Laguiller, que l’on croyait relégué aux franges de la gauche prolétarienne, reprend du service. Et de fait, il n’existe pas de meilleure expression pour désigner salariés du privé, agents du public, ouvriers, cadres et employés, jeunes et vieux actifs, venus s’exprimer, dans toute la France et souvent pour la première fois, sur leur quotidien au travail. L’immense majorité d’entre eux, sympathisants de gauche comme de droite, ne se voit tout simplement pas faire du rab, en tout cas pas dans ces conditions.
Qu’on soit investi dans son travail ou pas n’y change pas grand-chose, l’addition de la charge physique et mentale peut être salée. Et la retraite, selon l’expression désormais consacrée, est devenue le miroir grossissant des inégalités de carrière. En bout de chaîne, le régime des retraites a beau réduire la pauvreté des seniors et les écarts de pensions femmes-hommes, il reste bien en peine de gommer la faiblesse des rémunérations ou des périodes de chômage.
Corriger ces inégalités, « ce n’est pas le combat de la réforme des retraites », se défendait le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, le 6 février sur France Inter. Mais il existe deux façons de mener ce combat. Soit considérer qu’il est urgent de réformer les retraites pour des questions budgétaires, sans attendre d’en finir avec les dysfonctionnements du marché du travail qui prendraient de toute façon trop de temps à être résolus. Quitte à aggraver ces inégalités par une mesure d’âge qui frappera celles et ceux qui ont déjà la plus grande peine à travailler jusqu’à 62 ans. Soit estimer au contraire qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Car des solutions existent pour changer le travail et garantir du même coup l’équilibre financier du régime. Voici quelques pistes pour tendre vers un travail de qualité.
S’attaquer vraiment à la pénibilité
« La retraite avant l’arthrite », « Métro, boulot, caveau… », « Ne pas passer sa vie à la gagner »… Depuis janvier, les pancartes des manifestants disent un mal-être général que les études viennent confirmer : le travail s’est bel et bien intensifié ces trente dernières années. Pour autant, ils sont nombreux à devoir prendre leur mal en patience. En 2017, près de 3 millions de salariés étaient exposés à un facteur de pénibilité ouvrant droit à un départ anticipé via le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), le dispositif de l’époque, mais le ministère du Travail chiffrait à 1,3 million seulement les bénéficiaires de la mesure, les employeurs ne déclarant pas systématiquement les expositions. Ripoliné la même année par les ordonnances Macron, le C3P, qui s’est trouvé amputé de quatre facteurs d’exposition sur dix (postures pénibles, charges lourdes, vibrations, exposition aux produits chimiques) et de son « P » de pénibilité au passage, n’a pas eu les effets escomptés.
« Le dispositif n’a plus aucune vertu de prévention », relève la Cour des comptes dans un rapport sévère de décembre 2022. Il n’est pas « à la hauteur des objectifs qui lui étaient assignés, dans un contexte où l’âge de départ en retraite recule par ailleurs », poursuivent les auteurs du rapport. Selon les chiffres de l’assurance vieillesse, seules 3 300 personnes ont ainsi pu partir plus tôt grâce au compte professionnel de prévention (C2P, incapacité permanente) en 2021, soit 0,5 % des départs. Quand par ailleurs plus de 100 000 nouveaux retraités continuent chaque année de liquider leur retraite au titre de l’invalidité et de l’inaptitude, indice supplémentaire d’un monde du travail en petite forme.
La situation nécessiterait, demandent les syndicats de salariés, de réintégrer les quatre critères manquants dans le C2P. Mais le gouvernement s’y refuse et envisage à la place de créer un fonds d’un milliard d’euros pour la prévention et de proposer un suivi médical pour les salariés exposés à ces risques. « Il faudrait déjà qu’il y ait suffisamment de médecins du travail pour assurer cette tâche, avance Catherine Delgoulet, professeure d’ergonomie au Cnam et responsable du Centre de recherche sur l’expérience, l’âge et les populations au travail (Creapt). Quant aux médecins traitants, ils ne peuvent pas entrer dans les entreprises et ne connaissent pas la réalité du travail. »
Pour inverser cette dynamique, la sociologue Dominique Méda trouve certaines propositions du débat public particulièrement intéressantes. En premier lieu sortir d’une optique individuelle de la prise en compte de la pénibilité en définissant une liste de métiers pénibles négociée au niveau des branches professionnelles. Chaque trimestre travaillé dans ce métier serait bonifié pour l’accès à la retraite. « Au moins, ce serait simple », plaide-t-elle. La chercheuse pense également important d’inciter les entreprises à améliorer les conditions de travail via un bonus-malus sur les cotisations sociales : « Majorer le taux de cotisation accident du travail lorsque l’entreprise présente une sinistralité anormalement élevée dans son domaine d’activité et le baisser dans le cas contraire apparaît comme une solution raisonnable. »
A ses yeux, une meilleure prise en compte de la pénibilité suppose aussi de commencer par se conformer aux obligations légales. En dépit d’une sanction de 7 500 euros, sans doute peu dissuasive, plus de la moitié des entreprises ne remplissent pas le document unique d’évaluation des risques. « Dans un contexte de disparition des CHSCT, dont la mission a été diluée dans le comité social et économique, il faut créer des espaces de consultation des salariés pour aborder ces questions de santé et leur donner plus de pouvoir dans les conseils d’administration », ajoute Dominique Méda.
Pour éviter l’usure professionnelle, « les entreprises peuvent anticiper en se dotant d’observatoires pour identifier les signes précurseurs infrapathologiques », ajoute Catherine Delgoulet. C’est le cas par exemple de l’observatoire Evrest, un dispositif de veille construit par des médecins du travail et des chercheurs qui propose des questionnaires aux salariés lors des consultations et auquel participent Airbus et EDF. « C’est un début. Les petites entreprises sont encore peu concernées », précise l’ergonome, membre du conseil scientifique.
Changer les façons de travailler
Les pistes de progrès doivent également porter, à ses yeux, sur les trajectoires des salariés tout au long de la vie. « Cela implique de penser le temps long et non de réagir au pied du mur, de créer des temps de respiration. Dans le nord de l’Europe ou au Canada par exemple, il est beaucoup plus facile de prendre des congés sabbatiques ou des temps partiels choisis », poursuit Catherine Delgoulet.
Parmi ces temps de pause, la semaine de quatre jours revient en grâce, y compris dans la bouche du ministre de la Fonction publique, Gabriel Attal, qui vante son expérimentation dans une Urssaf de Picardie. Sauf qu’il ne s’agit pas de véritable réduction du temps de travail mais de condenser la même quantité d’heures, en l’occurrence 36, sur quatre jours. On est loin de la proposition de la CGT. Pour la centrale de Montreuil, passer à la semaine de 32 heures sans baisse de salaire créerait, selon ses calculs, 1,7 million d’emplois et ferait entrer 13,6 milliards de recettes dans les caisses de retraite.
Le débat sur la valeur travail de cet automne, prélude à celui sur les retraites, révélait déjà cette exigence : les Français veulent travailler autrement, mieux et pouvoir vivre de leur salaire. Contrairement aux manifestations de 2019 contre le projet de réforme à points qui amalgamait surtout la colère des perdants de la fusion des 42 régimes (dont les régimes spéciaux ou les professions libérales…), cette réforme n’a jamais autant mis les conditions de travail au cœur de la contestation.
Il faut dire que la pandémie est passée par là. Le rapport au travail a changé pour l’ensemble des actifs. Les premières et secondes lignes, obligées de travailler exposées au virus, ont cru voir un début de reconnaissance de leurs métiers, alors jugés essentiels. Le Covid a jeté la lumière sur la pénibilité et la faiblesse de leurs rémunérations. Or, non seulement le projecteur s’est éteint très vite, mais ces mêmes travailleurs sont sommés de repousser leur départ de deux ans.
Ce qui n’est pas à la portée de tous. Une étude du Centre d’études de l’emploi et du travail (Ceet) sur la fin de carrière de ces secondes lignes, publiée en février dernier par les chercheurs Thomas Amossé et Christine Erhel, constate qu’entre 50 et 64 ans, ils sont plus nombreux que les autres à n’être ni en emploi ni en retraite (26 %, contre 15 % pour les salariés hors seconde ligne). 48 % des ouvriers non qualifiés du bâtiment, 32 % des agents d’entretien ou 28 % des caissières vivent ainsi dans ce sas de précarité.
Quant aux « confinés » qui ont apprécié ou subi le télétravail, ils ne portent plus non plus le même regard sur la façon d’exercer leur boulot. La pandémie a montré que la vie pouvait être courte et qu’il était sans doute vain de travailler sous de telles cadences, surtout pour les salariés vieillissants. D’où la nécessité de revoir l’organisation du travail. A commencer par la réinternalisation de certaines tâches. Le choix des entreprises d’externaliser des activités et de se recentrer sur leur cœur de métier a restreint la possibilité de reclasser des salariés sur d’autres postes.
« Dans un entrepôt logistique en zone rurale, un ouvrier de 42 ans, opéré deux fois des coudes et des poignets, nous confiait qu’il n’y avait plus de tâches annexes où pouvoir être affecté, comme tondre la pelouse ou l’entretien du site, souligne Coralie Perez, économiste à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tout cela a été confié à d’autres sociétés et sa plus grande crainte était d’être déclaré inapte. Pour beaucoup de salariés, la solution, c’est marche ou crève. » Une inquiétude justifiée : 95 % des salariés déclarés inaptes sont licenciés, détaille un rapport de 2019 de la Haute Autorité de santé sur la désinsertion professionnelle.
« Les entreprises raisonnent selon deux logiques. Soit par substitution : quand un senior ne tient plus le coup, il est remplacé par un jeune, quitte à l’épuiser lui aussi. Un intérimaire ou un CDD est embauché… Chacun est considéré comme interchangeable et polyvalent, ce qui entraîne une dévalorisation des personnes et des métiers. Soit par compensation : le management propose des primes, ou des départs précoces », abonde Catherine Delgoulet. Celle-ci défend une troisième voie : « Au lieu de s’accommoder de ce turn-over, on peut retourner la chaussette et partir du principe que le travail est soutenable. Je reprends une réflexion empruntée au philosophe Jacques Rancière qui voit dans le travail une émancipation par l’apprentissage. On peut se former tout au long de la vie, que ce soit en situation de travail ou par la formation professionnelle. »
Et Coralie Perez de renchérir : « Arrêtons de penser qu’on n’est plus capable de se former après un certain âge. Les études montrent que l’accès à la formation chute significativement après 55 ans. » Et c’est la double peine pour les moins qualifiés : 54 % des cadres de 50-59 ans ont la possibilité de se former ; ce n’est le cas que pour 18 % des ouvriers de cette tranche d’âge, pointe une étude du Céreq. « Il y a pourtant un enjeu pour l’économie à ne pas perdre ces compétences, à ce que les seniors puissent transmettre leurs savoirs », enchaîne la chercheuse.
Or, le compte n’y est pas. Y compris pour les plus diplômés. Selon une étude de l’Apec menée en 2021 sur des cadres seniors, les entreprises ne valorisent pas suffisamment la transmission de leurs savoirs et de leurs compétences en direction des plus jeunes : « Seulement 22 % des cadres seniors déclarent que leur entreprise a mis en place des actions en ce sens. »
Revaloriser la carrière des femmes
La photo générale est désormais bien connue : arrivées à la retraite, les femmes perçoivent une pension de 40 % inférieure à celle des hommes. L’écart se réduit à 28 % grâce aux pensions de réversion et aux bonifications enfants, mais ces décalages s’expliquent par des écarts de salaires importants et des interruptions de carrière.
« La solution est très simple, il faut augmenter les salaires, avance la sociologue Rachel Silvera, spécialiste des inégalités professionnelles. A la demande de la CGT, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a calculé qu’aligner les salaires des femmes sur ceux des hommes rapporterait 5,5 milliards de cotisations dans les caisses de retraite. Et si les femmes atteignaient le même taux d’emploi, ce serait encore plus. L’écart est toujours de 8 points de moins que les hommes. L’index égalité femmes-hommes est inefficace, c’est un cache-sexe. Toutes les entreprises ont une bonne note ! Il faut changer de politique et appliquer la loi qui existe depuis 1972 : les femmes doivent être payées selon le principe “à valeur égale, salaire égal”. »
Aux Québec, Royaume-Uni ou Portugal, les expériences qui consistent à comparer des métiers très féminisés (infirmières, cantinières) à des professions équivalentes occupées par des hommes (brancardiers, jardiniers) ont prouvé qu’il était possible de revaloriser les salaires des femmes.
« Si on ne s’attaque pas à ces inégalités, on court à la catastrophe, poursuit Rachel Silvera. Le report de l’âge à 64 ans va encore plus les pénaliser. » Selon les calculs de l’économiste Michaël Zemmour, 60 % des économies de la réforme vont peser sur les femmes. Elles vont en moyenne devoir travailler sept mois de plus, contre cinq pour les hommes. Faute d’avoir suffisamment cotisé, 20 % des femmes seront toujours obligées d’attendre 67 ans avant d’ouvrir leurs droits à la retraite et l’engagement du gouvernement à ne pas décaler à 69 ans l’âge d’annulation de la décote est loin de les consoler. Pas plus que la prise en compte des congés parentaux dans les carrières longues, qui ne concernera que de 2 000 à 3 000 femmes par an.
Quant à la pension minimale à 1 200 euros qui devait surtout les concerner, selon les déclarations de l’exécutif, il est désormais acquis que peu la percevront en totalité. Une majorité de femmes touchent le minimum contributif (sur 4,7 millions de bénéficiaires fin 2022, selon l’Assurance vieillesse), mais pour atteindre cet objectif de revalorisation à 1 200 euros, il faudrait qu’elles aient travaillé une carrière complète à temps plein au niveau du Smic. Un mirage statistique, car personne ou presque ne passe sa vie au Smic. Il s’agit en réalité d’une revalorisation de la pension de base minimale qui, pour les femmes de la génération 1972, s’élèverait en moyenne à 54 euros par mois, selon les chiffres du gouvernement.
Mais, surtout, de nombreuses femmes ont bien compris qu’elles perdaient le bénéfice des huit trimestres accordés par enfant et qu’elles devront travailler plus sans surcote. 33 % des femmes, soit 120 000 par an, peuvent aujourd’hui partir à 62 ans avec tous les trimestres requis, majoritairement grâce à ce dispositif (85 % des femmes ont des enfants) mais le report à 64 ans neutralise cet avantage.
« Les femmes ont beau être de plus en plus nombreuses sur le marché du travail, elles continuent d’assurer l’essentiel des tâches domestiques », rappelle Rachel Silvera, qui plaide aussi pour un vrai service public de la petite enfance. Et même si elles ne s’arrêtent plus forcément en congé parental, ce sont elles qui font des arbitrages en fonction des enfants, comme refuser un emploi mieux payé mais plus chronophage. Ce sont toujours elles qui occupent les emplois les plus mal payés, dans le secteur des aides à la personne notamment. Des métiers usants, physiquement et psychiquement.
Les promoteurs de la réforme font remarquer que l’espérance de vie à la naissance d’une ouvrière (85,7 ans) est sensiblement la même que celle d’un homme cadre (84,9 ans). Mais dans quel état de santé ? « Les années d’espérance de vie supplémentaires des femmes sont en majeure partie des années en mauvaise santé », soulignent les chercheurs Ulysse Lojkine et Julien Blasco. A 30 ans, une ouvrière peut espérer vivre 55,7 ans dont 21 avec incapacité, soit 10 ans de plus en mauvaise santé qu’un cadre.
Santé et qualité de vie au travail, rapport au travail et démocratie sociale… Ce sont précisément les thèmes qui sont abordés aux Assises du travail, qui ont été lancées le 2 décembre dernier, par le ministre du Travail Olivier Dussopt sous la pression des syndicats. Dommage que les conclusions qui seront connues après le débat parlementaire n’aient guère de chance d’infléchir une réforme qui a mis de côté les inégalités de carrières professionnelles.
Retrouver notre dossier : « Retraites : la réforme qu’il faudrait »





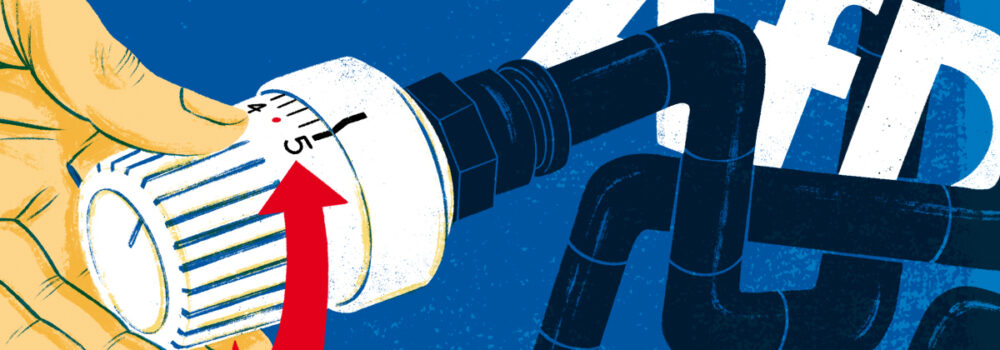









 RSS - Articles
RSS - Articles
Laisser un commentaire