La vie infernale du livreur


La scène est devenue commune dans les villes grandes et moyennes : des grappes de jeunes hommes, souvent immigrés, attendent devant un restaurant. Non pas pour y manger, mais pour récupérer un burger-frites ou un bo bun, avant de pédaler sous la pluie ou de foncer à scooter dans la nuit pour le livrer. Payés à la tâche, à la merci des plates-formes, sans protection sociale, ces livreurs à deux-roues sont le bout de la chaîne économique de la livraison. De nouveaux tâcherons, devenus symboles de l’économie ubérisée, qui ont vu leurs conditions de travail se dégrader, mais comment ?
« S’ils améliorent pas les conditions de travail et tout, les tarifs, les rémunérations, je pense pas pouvoir continuer à faire de la livraison même si on a des avantages et tout. » Mounir a 28 ans. Il est Algérien et travaille depuis deux ans pour Deliveroo et Stuart, deux plates-formes. Avec une cinquantaine d’autres livreurs, il s’est confié à une équipe de chercheurs, qui ont réalisé un rapport pour le Forum vies mobiles, un think tank créé par la SNCF. Mounir fait partie des 18 livreurs catégorisés par les scientifiques comme des « forçats », les plus précaires. Presque tous étrangers, qui travaillent souvent sept jours sur sept.
Il y a aussi les étudiants et les cumulants, qui livrent à temps partiel à côté de leur travail ou de leurs études, et forment un autre tiers de l’échantillon, avec les quelques intermittents, qui livrent peu mais sans autre activité. Le dernier tiers est composé des actifs qui travaillent pour les plates-formes environ 35 heures par semaine et des coursiers qui, eux, sont embauchés par des entreprises classiques ou des coopératives de livreurs. Ces derniers sont tous Français, plus diplômés… et peu représentatifs des 50 000 livreurs à deux-roues. Selon l’enquête réalisée en 2021 sur 500 livreurs du nord-est parisien par la chercheuse Laetitia Dablanc, de l’université Gustave Eiffel, seulement 10 % ont la nationalité française.
Motorisation et sous-location illégale en hausse
Arrivé en France en 2019 avec un visa étudiant espagnol, Mounir fait partie de cette majorité de livreurs étrangers. Comme lui, beaucoup n’ont pas le droit de créer leur société pour devenir auto-entrepreneur et travailler pour les plates-formes. Seule solution : sous-louer discrètement le compte d’un livreur « officiel », à qui ils laissent environ un quart de leurs maigres revenus, parfois plus. Une véritable économie de la sous-location s’est ainsi mise en place : dans l’édition 2020 de son enquête sur les livreurs, Laetitia Dablanc a estimé que 37 % des 300 livreurs interrogés « partageaient » un compte.
Un livreur sans-papiers ivoirien résume avec ses mots la situation, dans le livre Ubérisation, piège à cons (Robert Laffont, 2021), écrit par le journaliste de Libération Gurvan Kristanadjaja : « On fait ce boulot car les Français ne veulent plus le faire. Pour gagner 1 500 euros par mois, il faut travailler près de douze heures et sept jours par semaine. » Selon les résultats récoltés par Laetitia Dablanc, les livreurs sont en effet rémunérés moins que le Smic horaire : 80 % déclarent gagner moins de 1 500 euros par mois, et les 40 % qui gagnent entre 1 000 et 1 500 euros disent travailler en moyenne 171 heures par mois (contre 150 heures de travail pour un Smic mensuel de 1 554 euros).
Comme les chauffeurs de VTC avant eux, les livreurs à vélo ont été attirés par des rémunérations favorables quand les plates-formes voulaient se lancer en France. « J’ai commencé en 2014. A l’époque, on était 50 en France. Chez Take Eat Easy, la course valait 7,50 euros et nous avions des courses garanties », raconte Jérôme Pimot, ex-livreur qui a fondé en 2017 le Collectif des livreurs autonomes de Paris (Clap 75). « Ce fonctionnement a attiré beaucoup de livreurs, donc des clients, et facilité les levées de fonds des plates-formes. Mais très vite, quand les livreurs ont afflué, les bonus et les primes ont disparu. Maintenant la course atteint plutôt 3 euros… » Ainsi, en 2017, Deliveroo est passé d’une rémunération à l’heure à une tarification à la course, au départ plus élevé. Puis le tarif des courses a commencé à baisser, poussant les livreurs à augmenter leurs cadences pour maintenir leur revenu.
Vu ces cadences et la pénibilité physique liée à l’usage du vélo, un nombre croissant de livreurs utilisent désormais un scooter. Dans son étude de 2021, Laetitia Dablanc estime que 36 % des livreurs du nord-est parisien sont motorisés. Une enquête de France info arrive même au chiffre de 81 %, sur un millier de livraisons analysées à Paris et en proche banlieue. Interrogé, le porte-parole de Deliveroo admet que ses livreurs sont « grosso modo 50 % à vélo et 50 % à scooter ».
Confrontées à ce phénomène, des villes comme Nantes ou Montpellier ont interdit les scooters en centre-ville, sanctionnant à coups d’amendes les livreurs contrevenants. D’autres livreurs, en dehors des grands centres-ville, ont même choisi la voiture pour travailler, afin de couvrir des distances plus grandes et de se protéger des intempéries. Laetitia Dablanc rappelle pourtant que l’usage d’un véhicule motorisé pour la livraison « nécessite théoriquement l’obtention d’une licence de transport intérieur », et s’étonne de « l’impunité totale » en la matière.
De la désillusion à la lutte
« Il y aura toujours des livreurs plus pauvres qui accepteront des courses moins chères », déplore Jérôme Pimot, qui revendique un tarif horaire garanti pour tous les livreurs. Une demande partagée par les nombreux autres syndicats de livreurs nés ces dernières années. Parfois, ils obtiennent gain de cause, comme en décembre 2020 quand, après plusieurs grèves, les livreurs de Saint-Etienne obtiennent d’Uber Eats une garantie de salaire minimum aux heures de pointe. Quelques semaines plus tard, Just Eat annonce sa volonté d’embaucher 4 500 livreurs en contrat à durée indéterminée en France.
Autre motif de réjouissance, plusieurs décisions de justice récentes vont dans le sens d’une reconnaissance du statut de salarié des livreurs, notamment deux arrêts de la Cour de cassation de 2018 et 2020 concernant un livreur Take Eat Easy et un chauffeur Uber. Sans oublier la condamnation de Deliveroo pour travail dissimulé au conseil des prud’hommes de Paris en 2020. Mais cette nouvelle jurisprudence ne change pas le quotidien de la majorité des livreurs qui n’iront pas demander en justice leur requalification. La balle reste donc dans le camp du législateur, qui doit choisir entre doter les livreurs du salariat ou inventer un nouveau statut pour sortir de l’hypocrisie de l’auto-entrepreneuriat. En Espagne, le gouvernement a tranché : le salariat est devenu obligatoire à partir du 12 août. En conséquence, Deliveroo envisage de cesser ses activités dans le pays.
Sans attendre une régulation des plates-formes digne de ce nom, certains livreurs tentent de développer un contre-modèle plus vertueux. Dans de nombreuses villes françaises, des structures de cyclo-logistique associatives ou coopératives sont nées. La fédération CoopCycle en compte 40, ainsi qu’une trentaine à l’étranger. « Pour qu’un groupe de livreurs intègre CoopCycle, il faut qu’il se structure en coopérative et qu’il soit fondé sur un modèle salarial », explique Serge Mignonsin, cogestionnaire de la fédération et cofondateur de Rayon9, une coopérative de livreurs basée à Liège (Belgique), qui compte huit salariés. « Ensuite, nous aidons les collectifs à monter une activité pérenne, afin de montrer aux autorités qu’il est possible d’avoir de la livraison vertueuse, qui ne repose pas sur la précarisation. »
Côté français, la coopérative Olvo, basée à Paris, est l’une des plus florissantes, avec plus de 30 salariés, qui livrent des fleurs, des bières locales ou des plats de restaurateurs qui refusent de travailler avec les plates-formes. CoopCycle met à sa disposition et à celle d’autres coopératives de livraisons françaises son application, qui permet aux clients de commander chez les commerces partenaires. « Par contre, on ne livre pas McDonald’s ! », s’amuse Serge Mignonsin. Si vous n’êtes pas refroidis, il vous en coûtera 6 euros par livraison. Le prix de l’éthique ?
Retrouvez l’intégralité de notre dossier « La course folle de la livraison »






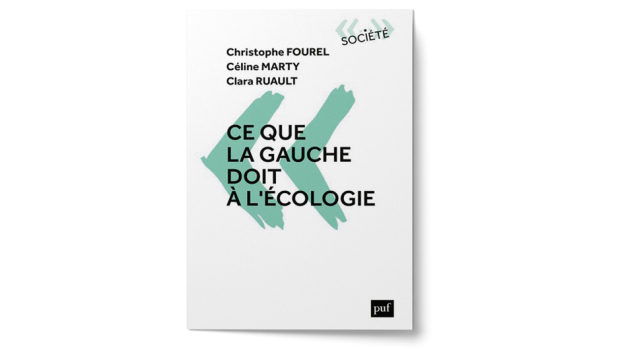





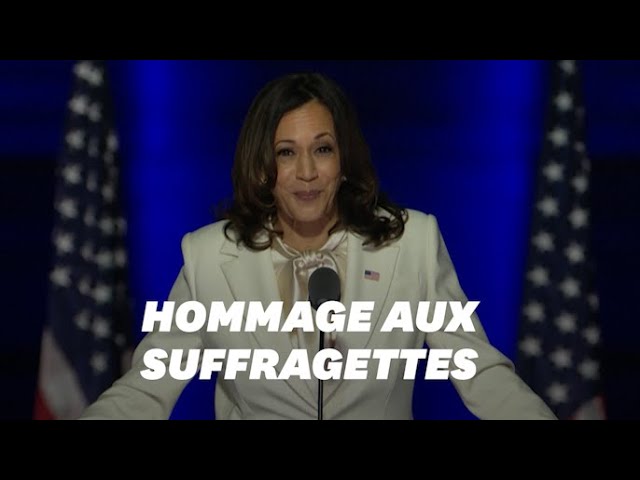


 RSS - Articles
RSS - Articles
Laisser un commentaire