Les profs face à la retraite : après 60 ans, « c’est le métier qui me quitte »
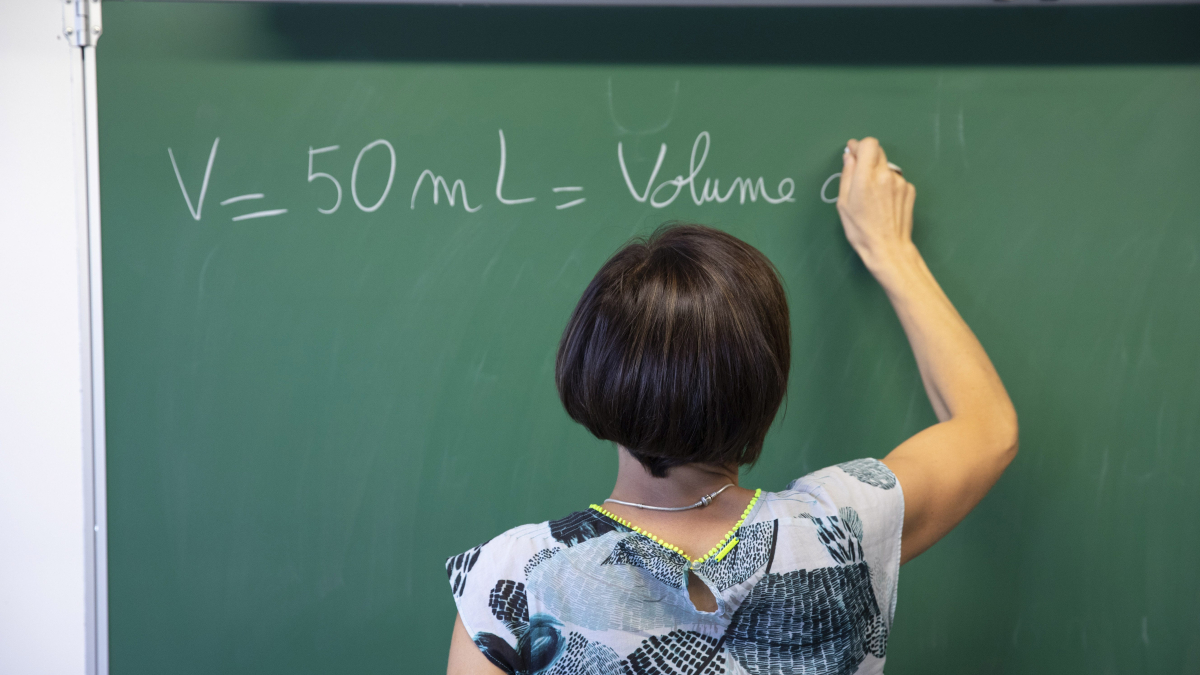
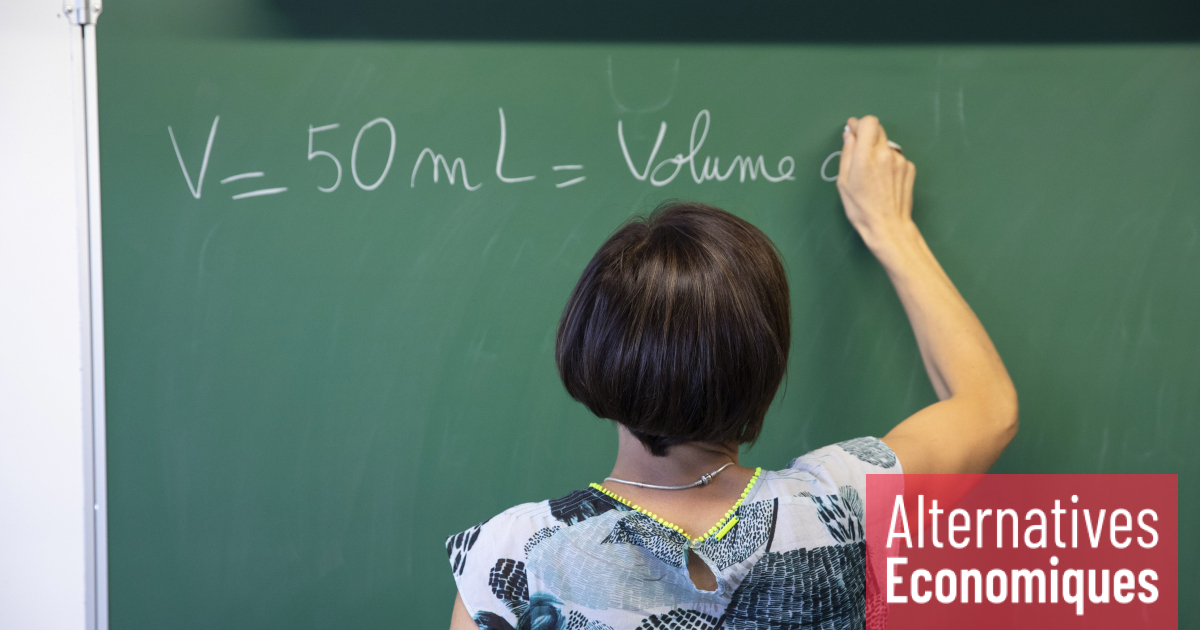
C’est une pancarte comme il y en avait tant dans les rues de Paris, jeudi 19 janvier : « Enseigner en saignant » a écrit Marie sur son bout de carton. Avec les collègues de son école maternelle de Montreuil, l’enseignante de 36 ans tenait à marcher contre la réforme des retraites, auprès des 80 000 autres manifestants – 1,2 million dans tout le pays.
Au niveau de l’Éducation nationale, le taux de grévistes montait à 35 % selon le ministère, 70 % selon l’intersyndicale. Si les enseignants se sont massivement mobilisés contre cette réforme, c’est parce que le report de l’âge de la retraite apparaît contradictoire avec l’énergie qu’exige leur profession.
La réforme esquissée par le gouvernement d’Élisabeth Borne impose le passage de 42 années de cotisation à 43 années, ce que les experts appellent « l’accélération de la loi Touraine ». C’est précisément ce qui a poussé Louise, 28 ans, à descendre dans la rue. Titulaire depuis deux ans, la jeune fille enseigne en maternelle dans le nord de la capitale et n’avait jusque là jamais songé à sa retraite :
« Aujourd’hui, on arrive plus tardivement dans le métier qu’avant, puisque le concours se déroule après un master. Avec un cursus dans le supérieur pas linéaire et deux tentatives du concours, je devrais attendre 68 ans pour avoir mes 43 annuités ! »
En plus de la masterisation de la formation des enseignants, cette arrivée tardive dans le métier a été accentuée par la réforme menée sous le mandat de Jean-Michel Blanquer, qui a décalé les concours de recrutement de l’éducation nationale à la fin de la deuxième année de master.
« Avant, le concours se déroulait à la fin du M1, rappelle Catherine Nave-Bekhti, du Sgen-CFDT. Cela posait plusieurs problèmes mais, après l’avoir obtenu, les lauréats passaient leur M2 en tant que fonctionnaires-stagiaires, ce qui leur permettaient de cotiser plus tôt. Actuellement, ils passent leurs deux années de master en stage ou en apprentissage, sans avoir la possibilité de cotiser. »
Des annonces « violentes »
Jean, également dans la manifestation parisienne, est lui « de la vieille école », plaisante-t-il. À bientôt 61 ans, il a commencé sa carrière bien plutôt que sa collègue, après un bac+3. Mais aujourd’hui, l’enseignant en mathématiques voit sa retraite s’éloigner de quelques années. « Les annonces du gouvernement ont été extrêmement violentes et brutales, sans d’autres arguments que le fameux « vivre plus longtemps implique de travailler plus longtemps » », souligne-t-il.
Les 43 annuités, Jean les aura remplies l’année prochaine. Mais si la réforme passe, il devra attendre deux ans de plus avant d’avoir l’âge minimum légal – 64 ans – pour partir à la retraite. « Je me sens sacrifié », soupire l’enseignant.
« Beaucoup de collègues vivent mal cette décision très unilatérale sur leur retraite, remarque Gilles Langlois du SE-Unsa. Ils vont devoir travailler deux ans de plus, sans obtenir aucun apport supplémentaire. Alors que, dans le système actuel, avec ces deux années supplémentaires, ils auraient droit à une surcote. »
Cocktail explosif
Le mode de calcul de la pension ne touche pas, en revanche, au mode de calcul de la pension qui, pour les enseignants comme tous les fonctionnaires, reste basée sur les six derniers mois de carrière. Mais cela est loin de satisfaire les professeurs, en pleine négociation sur la revalorisation des rémunérations rue de Grenelle.
« On le sait depuis longtemps, les salaires des prof sont loin d’être satisfaisants. Si la situation est plus enviable en fin de carrière, il faut aussi souligner que la grille salariale se tasse », rappelle Franck qui, après presque 30 ans de métier, touche 2 500 euros nets par mois.
« Les mesures provocatrices du gouvernement, la dégradation des conditions de travail, la chute de notre pouvoir d’achat… Tout cela s’accumule » – Sophie Vénétitay, Snes-FSU
Lui a le sentiment de regarder passer les annonces de revalorisation, sans jamais en bénéficier. « Elles se concentrent sur les débuts de carrière, c’est qui est une bonne chose. Mais c’est toute la grille salariale qu’il faut revaloriser ! »
Secrétaire du Snes-FSU, Sophie Vénétitay constate que la réforme des retraites vient s’ajouter au sentiment de ras-le-bol général dans la profession : « Les mesures provocatrices du gouvernement, la dégradation des conditions de travail, la chute de notre pouvoir d’achat… Tout cela s’accumule. Avec la réforme des retraite, ça explose. »
Les précaires oubliés
Sa collègue de premier degré, Guislaine David, co-secrétaire du Snuipp-FSU, évoque aussi les personnels de l’éducation précaires qui se retrouvent davantage lésés par cette réforme, des emplois largement féminisés.
« Les 135 000 AESH [accompagnants des élèves en situation de handicap, NDLR], que compte l’Éducation nationale, gagnent parfois moins de 800 euros par mois. Embauchées en CDD, même si la loi vient d’introduire une Cdisation pour certaines, elles subissent un emploi à mi-temps et de carrières souvent hachées. En bref, elles cumulent tous les handicaps pour la retraite. »
Autre question qui demeure : les périodes de contractualisation, avant titularisation, seront-elles prises en compte dans le calculs des annuités ? « Le gouvernement répond que les périodes de contractualisation seront prises en compte à partir de l’application de la réforme. Mais quid de ceux qui sont contractuels cette année, ou depuis bien plus longtemps ? » s’inquiète Gilles Langlois.
Pour les enseignants du primaire, une autre contrainte persiste : celle de terminer l’année scolaire commencée. « Si on est né en octobre, il nous faut continuer à travailler jusqu’au mois de juillet, soit presque une année supplémentaire ! », souligne Guislaine David du Snuipp-FSU.
Une exception contre laquelle les syndicats se battent depuis des années, mais les ministères de l’Éducation et de la fonction publique se renvoient la responsabilité. Cette mesure pourrait faire partie des discussions sur le texte de la réforme.
Une pénibilité méconnue
Pour les enseignants, ce qu’ignore cette réforme des retraite, c’est avant tout la pénibilité de leur travail, quasiment jamais reconnue.
« Cela tient aux formes de la pénibilité que l’on met en avant aujourd’hui, explique Dominique Cau-Bareille, ergonome et maître de conférence à Lyon-II. Les critères actuels prennent en compte des efforts physiques importants. À l’opposé, dans les métiers dits légers, la pénibilité est invisible. »
La chercheuse a mené plusieurs études sur la fin de carrière des enseignants, notamment ceux de maternelle : « Force est de constater qu’enseigner, cela use le corps et l’esprit. »
« En classe, il faut faire attention à tout, tout le temps. Et aussi susciter l’intérêt des élèves. Cela demande une implication totale » – Dominique Cau-Bareille, ergonome
Une pénibilité qui touche différemment chaque enseignant, mais qui est belle est bien présente pour chacun d’entre eux. Jean évoque sa douleur à l’épaule droite « à force d’écrire au tableau » et les lumbago de sa compagne, qui enseigne en maternelle. Louise, elle, n’est pas épargnée par son jeune âge : « Lorsque le vendredi arrive, j’ai mal aux genoux. Il faut dire que je passe une grande partie de mes journées accroupie pour être à la hauteur de mes élèves. »
La pénibilité est également cognitive, pointe Dominique Cau-Bareille. « En classe, il faut faire attention à tout, tout le temps. Et aussi susciter l’intérêt des élèves. Cela demande une énergie, une implication totale de soi. ». Franck, qui enseigne le français dans un collège breton, rigole en disant que son métier, c’est être acteur, comme au théâtre. « Je fais un one man show d’une heure, plusieurs fois par jour. À la fin de la journée, je me sens vidé jusqu’à l’os. »
Face à cette usure professionnelle, les arrêts de travail, et avec eux les besoins de remplacements, se multiplient. « Il faut aussi souligner l’enjeu du développement de la médecine du travail et de prévention dans l’Éducation nationale », souligne l’universitaire Dominique Cau-Bareille. Pour 1,2 million d’agents en 2021, le ministère comptait seulement 65 médecins du travail.
Comment tenir ?
Pour toutes ces raisons, Franck va demander un départ à la retraite anticipé à la fin de l’année. Il vient de fêter ses 59 ans et s’offre « une faible retraite avec décote ». En moyenne, les enseignants partent à la retraite à 60 ans dans le premier degré, 63 ans au collège et au lycée. « Mais c’est dans la l’Éducation nationale que l’on a le plus de demandes de départ anticipé par rapport aux autres corps de la fonction publique », précise Dominique Cau-Bareille.
Pourtant, ce métier, Franck l’aime et l’a choisi « par vocation » : « J’ai demandé un mi-temps que le rectorat m’a refusé. Je n’ai pas d’autre choix que d’arrêter. C’est dommage car, avec l’expérience que j’ai accumulée, je me sens meilleur professeur que je n’ai jamais été. Mais là, mon corps ne tient plus. »
L’enseignant sourit en paraphrasant le rappeur Booba, que ses élèves lui ont fait découvrir : « C’est pas moi qui quitte le métier. C’est le métier qui me quitte. »


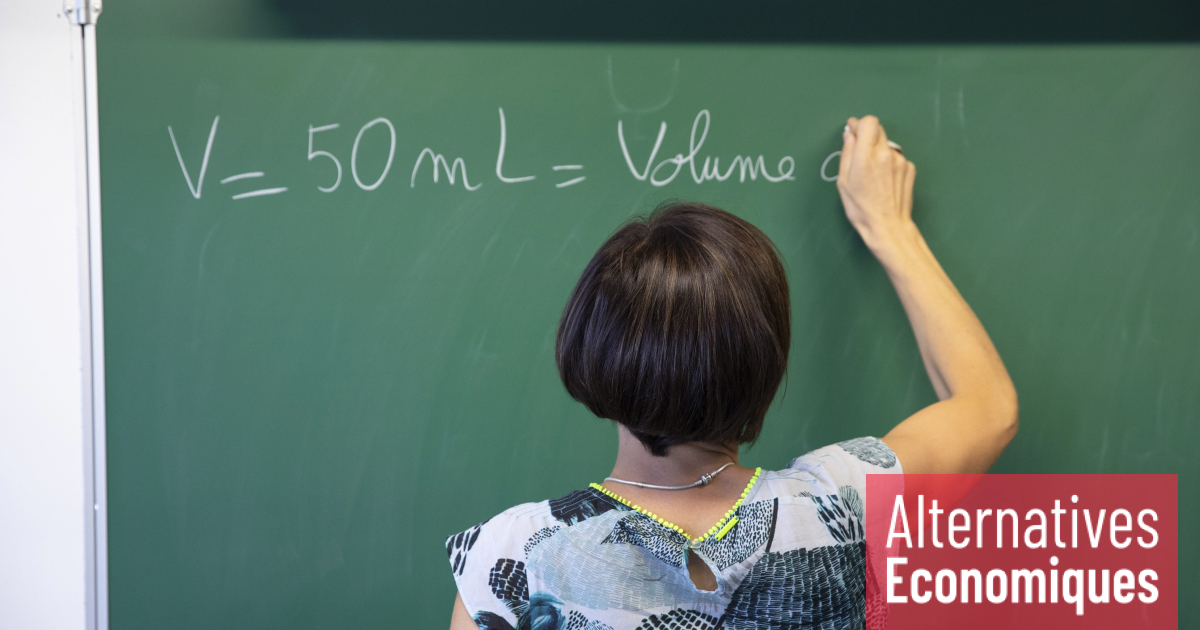









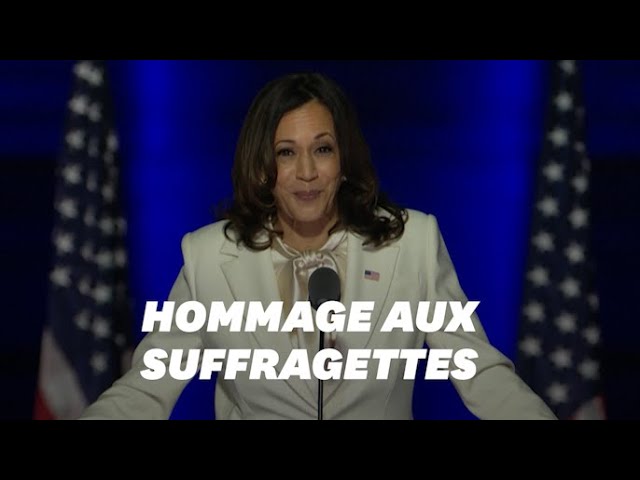


 RSS - Articles
RSS - Articles
Laisser un commentaire