Pourquoi la France est-elle incapable de passer des compromis sociaux ?
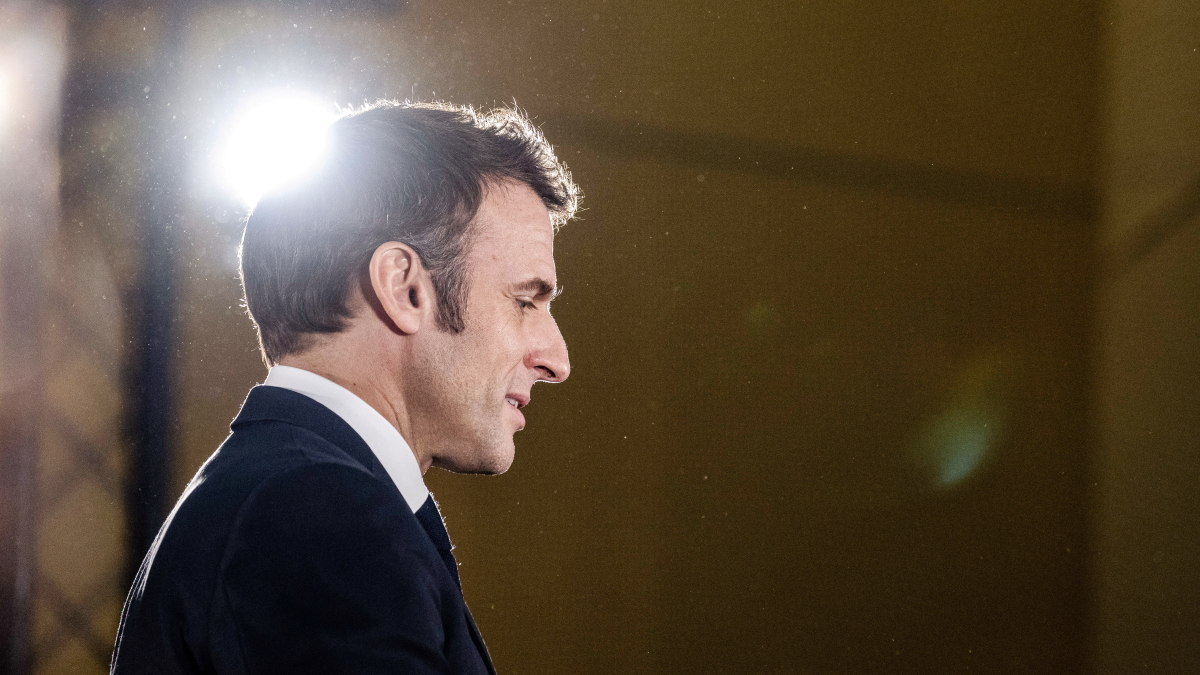

La désastreuse réforme des retraites pose de nouveau une série de questions récurrentes pour la société française. Pourquoi n’arrive-t-on quasiment jamais à y négocier des compromis sociaux ? Pourquoi ces grèves, ces manifestations à répétition que la plupart de nos voisins ne connaissent guère, en tout cas dans des proportions comparables ? Et que pourrait-on faire pour y remédier ?
C’est une longue histoire qui remonte jusqu’à la Révolution Française. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, celle-ci fut avant tout un grand moment de libéralisme sur le terrain économique et social. Une des premières tâches que se donnèrent les Révolutionnaires fut en effet d’abolir les corporations, qui freinaient le dynamisme économique du pays.
Mais avec elles, ils interdirent aussi toutes les formes de syndicalisme naissant et de négociation contractuelle avec le décret d’Allarde et la loi Le Chapelier adoptés en 1791. Devant la Convention, Isaac Le Chapelier posait clairement les enjeux : « Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation. » Entre l’Etat et le citoyen, la République ne veut connaître aucun « corps intermédiaire ».
Pendant que dans le reste du monde occidental, les syndicats se développaient progressivement, il faudra attendre 1864 pour que la grève et la coalition ne soient plus considérés comme des délits en France et 1884 pour que les syndicats soient officiellement reconnus.
En 1895, syndicats et bourses du travail se fédèrent pour former la CGT, mais celle-ci décidera en 1906 avec la Charte d’Amiens de ne pas chercher à joindre ses forces avec les socialistes qui venaient de réaliser leur unité l’année précédente, contrairement à ce qui s’était produit dans quasiment tous les autres pays développés. Cette occasion manquée a contribué à diviser et affaiblir durablement le mouvement ouvrier. Elle a retardé la reconnaissance institutionnelle du syndicalisme.
Durant toute cette période, la négociation sociale reste toujours très limitée en France et le syndicalisme activement combattu par les pouvoirs publics, et notamment par Georges Clemenceau. Pendant la guerre de 1914-1918, la CGT fut cependant associée à la gestion de l’économie de guerre.
Mais, après 1917, la révolution russe et la scission syndicale qu’elle a entraînée ont de nouveau affaibli et divisé le syndicalisme français. Il y eut bien en 1936 le Front populaire et ses conquêtes sociales mais l’épisode ne dura que quelques mois et fut suivi par une répression féroce durant la Seconde Guerre mondiale.
Il y eut ensuite le Conseil national de la résistance et son fameux programme puis la reconstruction, avec le Commissariat au plan auquel le syndicalisme était étroitement associé. Mais la guerre froide a de nouveau affaibli et divisé rapidement le syndicalisme.
La négociation sociale patine sous la Ve République
La Ve République n’a jamais été très portée vers la négociation sociale. Au contraire, Charles De Gaulle avait écarté en 1967 les organisations syndicales de la gestion de la Sécurité sociale. Mai 1968 apporta certes de nouvelles avancées pour les droits des travailleurs mais, les années suivantes, la droite, toujours au pouvoir, et le patronat ne firent rien pour encourager le développement de la négociation sociale dans un contexte de conflictualité accrue et de crise économique qui s’aggravait.
Depuis deux siècles, la France reste donc un pays où les questions sociales se règlent principalement par la loi ou dans la rue et sur les barricades
Quand la gauche arriva au pouvoir en 1981, il s’agissait cependant d’une gauche marquée dans toutes ses composantes par les réflexes étatistes et jacobins en matière de droit social, peu à l’aise avec un syndicalisme français toujours aussi faible et de plus en plus divisé avec l’apparition de nouvelles organisations supplémentaires : Sud, Unsa, FSU…
Depuis deux siècles, la France reste donc un pays où les questions sociales se règlent principalement par la loi ou dans la rue et sur les barricades. Cela a son charme et peut apparaitre vu de loin comme romantique, mais du point de vue de l’efficacité économique et sociale, il n’y a guère de doute que nos voisins nordiques et germaniques tirent profit de leur capacité à dégager des compromis sociaux plus aisément et plus régulièrement.
Ils parviennent ainsi à faire évoluer leurs sociétés sans heurts majeurs. C’est grâce à cela que leurs économies sont à la fois plus innovantes et plus résilientes que la nôtre, notamment dans le domaine industriel, malgré un coût du travail élevé.
Avec sa conflictualité structurelle, la France est cependant aussi une exception sur ce plan vis-à-vis de l’Italie ou de l’Espagne, où, bien que le syndicalisme soit divisé selon des critères idéologiques comme en France (quoique dans une moindre mesure), on est parvenu à introduire une culture de pactes sociaux.
L’épisode « refondation sociale »
Après les fortes tensions suscitées par la mise en œuvre de la loi sur les 35 heures au tournant des années 2000, un consensus s’était cependant établi pour considérer que, dans le domaine social, nous avions trop de lois et pas assez de contrats. Et qu’il fallait en conséquence élargir l’espace de la négociation sociale.
C’est ce qu’on avait appelé à l’époque la « refondation sociale » portée notamment par le Medef d’Ernest-Antoine Seillière et la CFDT dirigée alors par Nicole Notat. Même la CGT de Bernard Thibault, qui s’était détachée du PCF et cherchait sa place dans le paysage institutionnel français, n’y était pas hostile. Elle approuvera en particulier en 2006 une position commune avec la CFDT, le Medef et la CGPME, en faveur d’une réforme de la représentativité syndicale pour la fonder sur les résultats électoraux dans les entreprises.
Cette volonté était aussi largement partagée dans le spectre politique. Sans l’avoir mise en œuvre quand elle était au pouvoir, la gauche de gouvernement ne pouvait cependant que souscrire à cette tentative de social-démocratisation de la société française.
Mais c’est surtout la droite, au pouvoir à l’époque, qui s’y était collée. L’actuel président du Sénat Gérard Larcher, alors ministre du Travail de Jacques Chirac, a laissé son nom à une loi allant en ce sens. Celle-ci prévoyait qu’avant de légiférer en matière de droit du travail, le gouvernement devait au préalable laisser les partenaires sociaux négocier.
Et s’ils parvenaient à un accord, celui-ci devenait la loi. Nicolas Sarkozy, lui-même, avait, au début de son mandat, soutenu ce mouvement en réformant la représentativité syndicale pour faciliter la négociation sociale à tous les niveaux en accroissant la légitimité démocratique des accords.
Cette démarche de social-démocratisation de la société française a cependant été mise en œuvre sans réelle conviction et bien souvent à reculons. La loi Larcher comportait beaucoup d’échappatoires et n’a que très rarement été pleinement appliquée.
L’urgence imposée par la multiplication des crises, et notamment la crise financière de 2008 et ses suites, a servi de prétexte à la technocratie pour imposer un retour de l’étatisme. Et surtout, la réforme de la représentativité syndicale a manqué son but. Elle avait été en effet conçue comme un moyen d’amener les syndicats à s’unir, et en particulier la CGT et la CFDT, en instaurant un seuil à 50 % pour valider les accords interprofessionnels.
Grâce à l’esprit de responsabilité manifesté par les organisations syndicales, l’opposition massive à la réforme des retraites a pris cette fois des formes non violentes. Mais le gouvernement n’y a vu qu’un signe de faiblesse permettant de faire preuve de davantage d’intransigeance
Mais l’affaiblissement de la CGT a fait que la CFDT et ses alliés « réformistes » ont obtenus seuls ce fameux 50 %, repoussant dès lors la CGT dans l’opposition systématique et aggravant ainsi au final la division syndicale au lieu de la réduire.
Au début de son mandat, François Hollande a bien essayé de revivifier quelque peu cette démarche social-démocrate. Mais il a très vite cédé aux instances jacobines et autoritaires de son Premier ministre Manuel Valls et de son ministre de l’Economie Emmanuel Macron, qui se faisaient une concurrence sévère pour savoir lequel serait le plus antisocial et le plus libéral en économie. Entrainant ainsi toute la gauche dans la catastrophe que l’on sait.
Etatisme et autoritarisme
Depuis le début de son mandat, avec les ordonnances travail, Emmanuel Macron a ouvertement choisi de suivre le chemin inverse de ces tentatives de social-démocratisation : celui de l’autoritarisme et de l’étatisme. Après avoir déclenché la révolte des Gilets Jaunes, la plus longue et la plus violente de tout l’après-guerre, avec une politique fiscale particulièrement injuste au début de son premier mandat, il a suscité le plus important mouvement social des trente dernières années avec le projet de réforme des retraites au début de son second mandat.
Grâce à l’esprit de responsabilité manifesté par les organisations syndicales, pour une fois unies contre ce projet, cette opposition massive a pris cette fois des formes non violentes. Mais le gouvernement n’y a vu qu’un signe de faiblesse permettant de faire preuve de davantage d’intransigeance encore que face aux Gilets Jaunes.
Peut-on sortir de cette dynamique perverse qui mène la société française dans le mur sur le plan tant démocratique qu’économique et social ? Ce n’est évidemment pas aisé dans la mesure où ces pratiques autoritaires et ce refus de la négociation sont profondément inscrits dans notre histoire. Mais il n’y a pour autant là rien de génétique ou d’irréversible.
Pour en sortir, il faudrait avancer dans quatre directions. Il faut tout d’abord changer la gouvernance des entreprises françaises qui restent pour l’essentiel des structures féodales. Il suffit pour cela de copier le modèle de gouvernance de nos voisins germaniques, leur codétermination qui donne aux représentants des salariés infiniment plus de pouvoirs qu’en France. Et cela dès le seuil de cinq salariés. Non seulement à travers la présence d’une moitié de représentants des salariés dans les conseils d’administration, mais aussi dans chaque établissement où les conseils d’entreprises ont des pouvoirs de veto étendus.
Il faut ensuite accroitre fortement la pression à l’union, voir à la fusion, des organisations syndicales pour sortir du paysage fragmenté qui affaiblit aujourd’hui terriblement le syndicalisme français. Cela passe notamment par un renforcement des règles régissant la validité des accords majoritaires : cette majorité doit être élevée au-delà de 50 %, à 66,6 % ou 75 %. On considère souvent que c’est impossible parce que cela impliquerait de trouver des accords avec la CGT ou Sud, considérés comme opposés à tout compromis. Il s’agit là d’une vision statique des choses : si leur responsabilité est engagée, ils sortiront très rapidement de cette posture.
Il faut également généraliser la présence effective de représentants des salariés dans les petites entreprises. Cela passe notamment par la création d’instances représentatives dans les réseaux de franchisés qui aujourd’hui structurent l’essentiel du commerce de proximité et des services aux personnes. C’est en effet pour une part significative l’abandon des salariés de ces petites entreprises qui nourrit le déclin du syndicalisme et de la gauche politique et la montée de l’extrême droite.
Il faut enfin remettre la loi Larcher sur le métier pour mieux préciser l’articulation entre démocratie sociale et démocratie politique à l’échelle nationale, en accroissant les pouvoirs du conseil économique social et environnemental (Cese) et en renouvelant la gouvernance de la protection sociale pour la sortir des griffes de Bercy.
La difficulté étant bien sûr que dans un paysage polarisé entre les libéraux purs et durs et les populistes jacobins de droite et de gauche, les forces susceptibles de porter un tel projet sont aujourd’hui très affaiblies.
Une part significative de l’avenir du pays dépend pourtant de notre capacité à tourner la page de l’autoritarisme et de l’étatisme dans la gestion du social. Comme le disait Guillaume d’Orange : « Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer… »





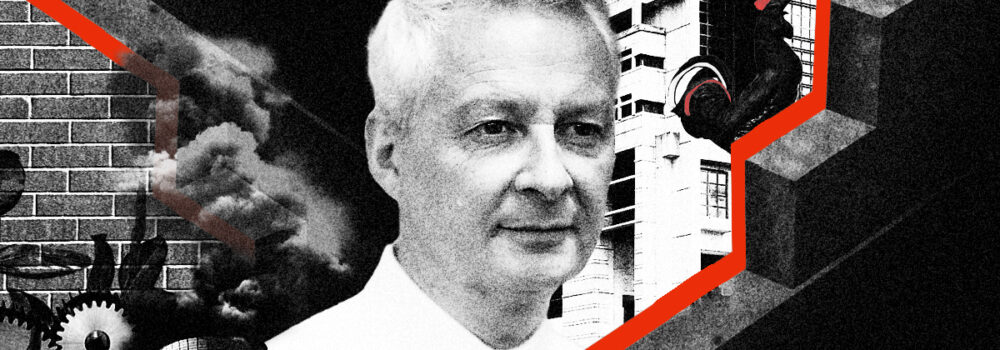






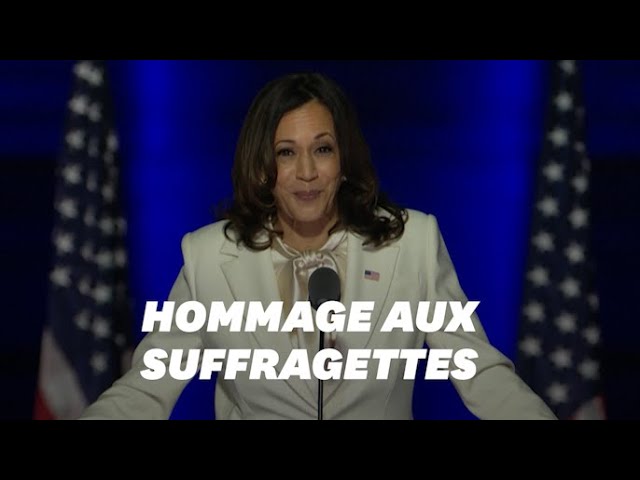


 RSS - Articles
RSS - Articles
Laisser un commentaire