Comment regarder Sabalenka contre Rybakina aux finales WTA 2024 en ligne gratuitement
Regardez en direct Sabalenka contre Rybakina aux finales WTA 2024 en ligne gratuitement depuis n’importe où dans le monde.
Regardez en direct Sabalenka contre Rybakina aux finales WTA 2024 en ligne gratuitement depuis n’importe où dans le monde.

Le budget 2025 se retrouve coincé. D’une part, la France affiche un important déficit dû à une gestion fiscale irrresponsable depuis 2017. Elle doit modifier son solde structurel primaire d’au moins 0,5 % chaque année jusqu’à ce que le déficit soit inférieur à 3 % du PIB. Cela a incité le Conseil de l’Union européenne à engager une procédure pour déficits excessifs (PDE) à l’encontre de la France en juillet dernier. D’autre part, le pays est confronté à un risque de récession, en particulier en raison de la situation économique en Europe.
En effet, l’Allemagne vient de réviser ses prévisions de PIB à – 0,1 % pour 2024. L’Europe a donc besoin d’une politique de stimulation budgétaire, qui pourrait être accompagnée d’un assouplissement monétaire facilité par un ralentissement de l’inflation. Mais en même temps, la France doit se restreindre financièrement. Une impasse ?
Néanmoins, il existe une possibilité de jongler avec les deux objectifs afin de maintenir la croissance. Cela repose sur deux leviers fondamentaux. Le premier est la cadence de l’ajustement – c’est-à-dire du retour à une trajectoire budgétaire plus rassurante ; le second est le mode de cet ajustement, que ce soit par le biais des recettes ou des dépenses.
Chaque dimanche à 17h, notre analyse de l’actualité de la semaine
Mi-octobre, le gouvernement a publié le Projet de loi de finances (PLF) pour 2025, qui prévoit un effort de 60 milliards d’euros en 2025 pour ramener le déficit sous la barre des 3 % d’ici 2029. Selon le Haut Conseil des Finances Publiques, cet effort équivaut à un ajustement du solde structurel primaire de 1,4 point de PIB en 2025, soit 41 milliards d’euros d’économies.
C’est un ajustement sévère. Est-il réellement nécessaire au regard des réglementations européennes ? Va-t-il effectivement permettre à la France de diminuer sa dette publique ? Sera-t-il récompensé et conduira-t-il à un ajustement allégé dans les années suivantes ? Non, selon le chercheur Jonas Kaiser, de l’Institut Avant-garde.
Tout d’abord, ce budget est indéniablement sévère, bien plus que ce que demandent les règles budgétaires européennes, qui recommandent un ajustement deux fois moins agressif que ce qui est prévu dans le PLF pour 2025. De plus, les règles européennes sont conçues de telle sorte qu’une austérité plus significative en 2025 (comme le propose le gouvernement) ne garantit pas nécessairement une austérité moins accentuée les années suivantes : une cure d’austérité minimale est en effet prévue chaque année.
Concrètement, si l’ajustement substantiel proposé par le gouvernement permet à la France de sortir deux ans plus tôt de la procédure de déficit excessif, cela ne la soustrait pas aux consolidations et économies futures.
Les nouvelles normes européennes ont établi des seuils « garde-fous », qui obligent la France à faire des efforts même après la fin de la période d’ajustement, quel que soit l’effort fourni la première année. Ainsi, soit le « garde-fou de la dette » exigera que la France diminue sa dette d’au moins un point de PIB par an (puis 0,5 % si elle descend en dessous de 90 % de dette sur PIB), soit le « garde-fou du déficit » lui imposera de réduire son déficit d’au moins 8 milliards d’euros (0,25 point de PIB) tant que son déficit n’atteint pas 1,5 %.
Selon le choix du scénario macroéconomique, cela peut aboutir, dans le pire des cas, à un ajustement cumulatif plus important, et au mieux à un ajustement cumulatif à peu près équivalent à ce que les règles exigent.
Dans les deux cas, cet effort accru au début de la période entraîne le risque d’un impact plus néfaste sur la croissance : par exemple, la prévision d’automne de l’économie française par l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économiques) indique que l’austérité budgétaire prévue dans le PLF pourrait réduire la croissance de 0,8 point de PIB en 2025, résultant en une croissance de 0,8 % l’année suivante … Ces résultats décevants, qui affecteront les recettes fiscales, inciteront à faire encore plus d’efforts dans les années à venir.
En d’autres termes, l’ajustement appelle l’ajustement, et la France risque de se retrouver dans un cycle de consolidation perpétuelle qui nuira à l’investissement du pays. C’est le scénario que traverse l’Italie depuis 1985… Cette direction est malvenue, alors qu’un rapport significatif, rédigé par Mario Draghi, a récemment appelé à 800 milliards d’euros d’investissements annuels supplémentaires en Europe pour que le vieux continent évite le déclin économique qui le menace.
Au-delà de la vitesse d’ajustement, l’autre enjeu réside dans la manière dont le gouvernement procède, afin de préserver à la fois la croissance et l’avenir, et ainsi d’éviter de tomber dans une spirale d’ajustement permanent.
Cependant, effectuer des coupes budgétaires et réduire les dépenses en période de récession est la pire des décisions à prendre, c’est la leçon majeure de la macroéconomie tirée de la crise de la zone euro dans les années 2010. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les plans d’austérité augmentent la dette publique à court terme en raison de leur effet récessif important (via l’effet multiplicateur). Ce qui pousse par la suite à un ajustement encore plus sévère. La Grèce, par exemple, continue d’en subir les conséquences aujourd’hui avec une croissance durablement altérée.
C’est a fortiori le cas lorsque les dépenses ciblées compromettent l’avenir, comme les coupes concernant l’éducation nationale (4 000 postes supprimés), la santé (diminution du remboursement des consultations médicales par la Sécurité sociale) ou l’écologie (réduction du Fonds Vert). D’autant plus que l’efficacité d’autres dépenses publiques n’a pas été analysée. Par exemple, il aurait été pertinent de discuter de l’intérêt de la mise en place d’une Grande Sécu ou de l’impact néfaste des niches fiscales nocives.
La bonne nouvelle de ce budget 2025 est qu’il remet en question le dogme de l’absence d’augmentations d’impôts, qui était une ligne rouge depuis 2017. Les augmentations de recettes peuvent avoir un effet récessif moindre, et c’est particulièrement vrai pour les hausses des prélèvements sur les entreprises, la suppression partielle des allégements de cotisations sociales et l’imposition des ménages aisés. Cela aurait pu être poussé plus loin, notamment parce que ce budget néglige complètement l’imposition du patrimoine, qui présente un rendement très élevé, n’entrave pas les investissements productifs et a un impact significatif sur la réduction des inégalités.
Une consolidation budgétaire trop rapide et trop sévère par rapport aux exigences de Bruxelles, des recettes mal ciblées et des baisses de dépenses mal choisies : en voulant trop bien faire pour se distinguer de l’idéologie des gouvernements antérieurs, le budget Barnier a des conséquences désastreuses sur la croissance et compromet l’avenir. Qui trop embrasse mal étreint.
Obtenez 55 % de réduction sur un moniteur Acer avec l’achat d’un PC de jeu Acer RTX 4070 Super grâce à cette offre BOGO chez Best Buy.
Diffusez en direct les finales WTA 2024 gratuitement depuis n’importe où dans le monde.
ABBYY présente Phoenix, une IA révolutionnaire destinée à perfectionner la gestion des documents des entreprises via des modèles SLM. Dévoilée lors du sommet ABBYY Ascend 2024, cette solution promet une augmentation de l’efficacité et une automatisation améliorée.

ABBYY, pionnier de l’automatisation des processus intelligents, a franchi une étape significative dans la gestion documentaire avec le lancement officiel de Phoenix le 30 octobre 2024. Cette intelligence artificielle multimodale s’appuie sur des modèles SLM pour afficher des performances proches des LLM, mais avec une efficacité supérieure. Voici les détails de cette annonce qui pourrait changer la façon dont les entreprises améliorent leur gestion documentaire.


Phoenix transcende l’idée d’un simple logiciel. Dévoilée lors de l’événement ABBYY Ascend 2024, elle fait partie intégrante du Purpose-Built AI Center, une plateforme conçue pour démocratiser l’accès à des outils d’intelligence artificielle. Ce centre vise à faciliter la création d’applications d’IA et à renforcer l’automatisation des processus. En utilisant les modèles SLM, les entreprises peuvent accroître leur retour sur investissement tout en garantissant agilité et rapidité.
Les modèles SLM d’ABBYY se distinguent par leur aptitude à intégrer aisément les documents dans les processus d’affaires. Cela garantit une réactivité face aux changements des exigences. Maxime Vermeir, Directeur Senior de la Stratégie AI chez ABBYY, a affirmé l’importance de cette innovation : « Avec le lancement de notre Purpose-Built AI Center, nous offrons à nos clients la possibilité de découvrir plus facilement la solution adaptée à leurs besoins opérationnels, simplifiant ainsi leur succès en matière d’automatisation. »
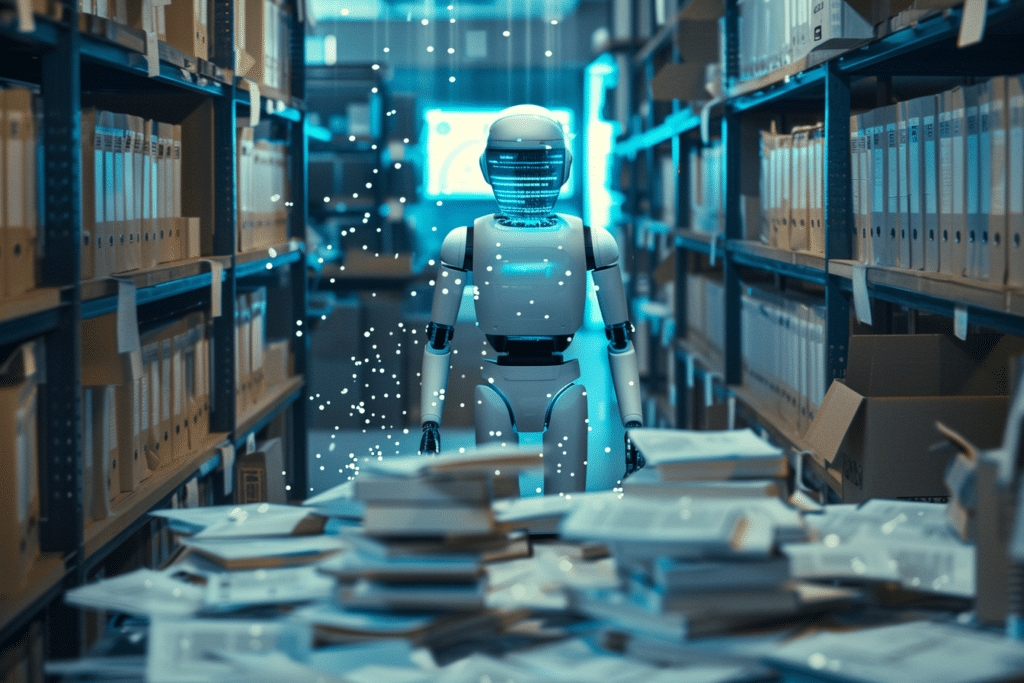
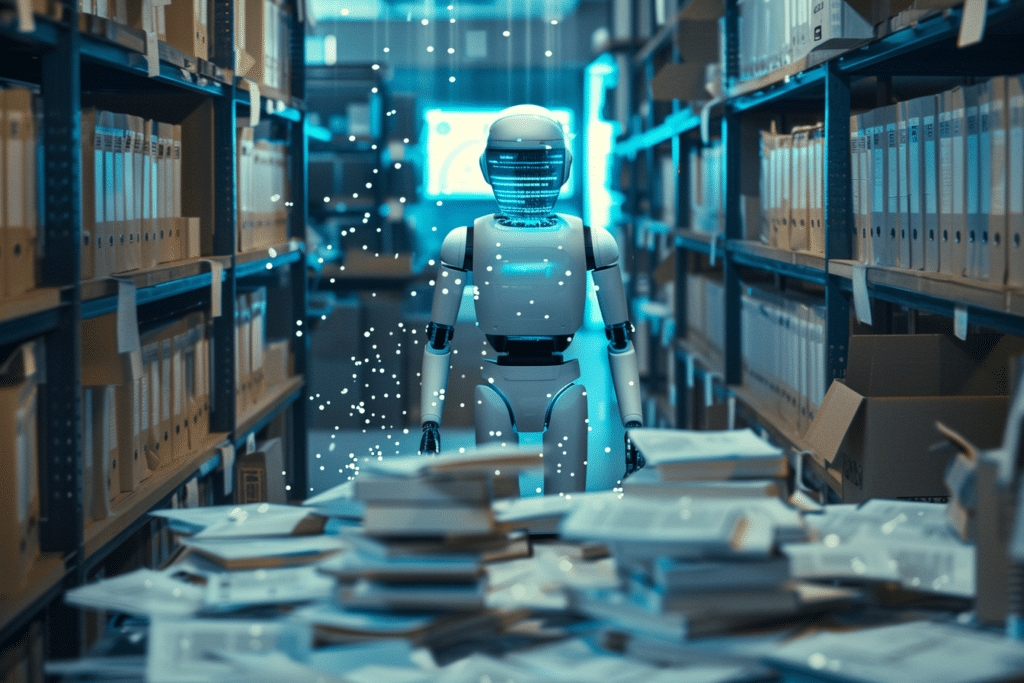
Dans le cadre de ses autres annonces marquantes, ABBYY a présenté sa solution IDP (Traitement Intelligent des Documents). Celle-ci constitue un passage sécurisé vers les LLM pour une extraction de données fiable. Ce dispositif a pour objectif de réduire le risque d’erreurs, telles que les hallucinations des modèles, et d’assurer la précision des données traitées. La sécurité et l’exactitude sont des priorités qui tiennent à cœur à l’entreprise, qui s’efforce de renforcer la confiance des utilisateurs dans la technologie. De plus, le Purpose-Built AI Center offre aux développeurs un accès centralisé à un ensemble complet d’outils d’IA. Cette plateforme prend déjà en charge plus de 80 modèles de documents, augmentant ainsi la capacité des entreprises à s’adapter et à innover dans leurs opérations quotidiennes.


ABBYY n’a pas seulement concentré ses efforts sur Phoenix et son centre AI. L’entreprise a annoncé des améliorations significatives de ses capacités OCR (Reconnaissance Optique de Caractères) pour optimiser la qualité de conversion et la détection des structures documentaires. Ces avancées permettent de traiter efficacement un volume plus important de documents tout en améliorant la mémoire et la rapidité. La reconnaissance de l’écriture cursive (ICR) est également mise en avant avec un soutien multilingue et des outils actualisés pour répondre aux besoins des entreprises en matière d’extraction de données complexes. Les développeurs profitent d’une intégration simplifiée grâce à une meilleure prise en charge des API et des langages de programmation comme .NET et Python.
Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

« En 2023, mon revenu est devenu négatif. Aujourd’hui, je repars à la hausse. » Suite à la crise qui a durement affecté les acteurs du bio durant les trois dernières années, Jérôme Caillé, agriculteur dans les Deux-Sèvres, retrouve de l’espoir, tout comme de nombreux de ses collègues.
Établi en 2002 sur une exploitation de 100 hectares dédiée à la grande culture, ce responsable d’exploitation s’est tourné vers le bio en 2011 et a commencé l’année suivante un élevage de volailles pour diversifier ses activités. En 2017, il a investi dans deux nouveaux bâtiments pour l’élevage avicole, encouragé par la forte augmentation de la demande : « Il y avait un manque de volaille bio partout. »
Évidemment, ce n’est pas la fortune assurée. Après avoir réglé ses charges, Jérôme Caillé parvient à tirer un revenu équivalent à 986 euros nets par mois grâce au bio. Mais au moins, son exploitation était fonctionnelle. Cela a duré jusqu’à cette année 2023, où il a subi à la fois la grippe aviaire et la perte de ses clients. Les vides sanitaires de ses poulaillers se sont transformés en absence de commandes.
L’inflation après le Covid et la hausse des prix en début de guerre en Ukraine ont dans un premier temps été bénéfiques. Mais rapidement, les consommateurs, touchés financièrement, ont restreint leurs acquisitions de produits bio, jugés plus coûteux que ceux conventionnels. Alors que le marché français du bio avait doublé entre 2016 et 2020 pour atteindre 13,3 milliards d’euros, sa croissance a été interrompue en 2021 (– 0,5 %), suivie d’un déclin en 2022 (– 3 %) et d’une stagnation en 2023 (0 %).
Dans les grandes et moyennes surfaces (GMS), représentant 50 % du marché, cette situation a incité les responsables à retirer des produits des rayons, en raison de la rentabilité des linéaires, entraînant ainsi une chute des ventes (– 2 % en volume en 2021, – 7 % en 2022, – 13 % en 2023).
Du côté des magasins bio spécialisés, qui représentent 28 % du marché, l’année 2023 a été marquée par 298 fermetures, après 200 en 2022. Seule la vente directe a su tirer son épingle du jeu. Cependant, bien que son poids soit significatif (14 % du marché), sa dynamique ne compense pas les pertes.
Ce choc sur la demande a impacté en amont. Pour les agriculteurs, les pertes ont été évaluées par la profession à environ 300 millions d’euros par an ces deux dernières années, partiellement compensées par 200 millions d’euros d’aides d’urgence octroyées durant la période 2023-2024. Pour la première fois, en raison des cessations d’activité et des reconversions, les surfaces en bio ont diminué en 2023 (– 1,9 %).
Depuis, l’inflation a diminué. Et la demande pour le bio recommence à augmenter. Mais cette reprise d’activité n’est pas uniquement due à cela. Avec la crise, Jérôme Caillé témoigne : « Des groupements de producteurs se sont complètement désinvestis. Cela libère un marché très étroit : environ 2 % de la volaille consommée en France est bio ».
Henri Godron, président de Biocoop et vice-président de Synadis Bio, qui représente la distribution spécialisée, observe une tendance similaire. « Le marché reprend des couleurs. Bien qu’il y ait encore des fermetures de magasins, l’hémorragie semble se ralentir. » Et après deux années difficiles, Biocoop a enregistré une progression de son chiffre d’affaires « de plus de 5 % » durant les trois premiers trimestres. Mais là encore, au-delà du fait que cette croissance débute à un niveau plus bas, « c’est aussi lié à la baisse du bio dans les grandes et moyennes surfaces. Cela a attiré chez nous des clients qui n’y trouvent plus leurs produits ».
Car la grande distribution, qui est le principal moteur de la demande adressée à l’amont, ne semble toujours pas redémarrer.
« Auchan, Intermarché… J’ai rencontré plusieurs distributeurs, tous ont reconnu qu’ils avaient ralenti trop fortement, que des consommateurs s’étaient tournés vers d’autres options, raconte Jérôme Caillé, qui est également président de la commission bio de la Coopération agricole. Ils affirment aujourd’hui vouloir garder de la visibilité dans les rayons. Système U l’a fait, mais les autres réfléchissent encore ». On y verra plus clair d’ici la fin de l’année, lorsque leurs commerciaux auront négocié volumes et prix pour 2025. »
Pour leur part, les entreprises de transformation n’ont pas encore constaté de changements notables. Au contraire, Claire Dimier-Vallet, directrice de Synabio, déplore : « Nos membres ont observé une baisse de 4 % de leur chiffre d’affaires dans les GMS au premier semestre 2024. »
« Les arrêts d’activité ont apporté un répit, résume Sophia Majnoni, déléguée générale de la Fédération nationale d’agriculture biologique – Fnab). Mais je ne constate pas de reprise structurelle, alors que nous n’atteignons qu’un dixième des surfaces en bio. »
Soit très loin des 18 % ciblés dans trois ans, selon l’engagement de la France formalisé dans son Plan stratégique national pour la Politique agricole commune 2023-2027. Et encore plus éloigné des 25 % envisagés au niveau de l’Union européenne d’ici 2030.
Pour y parvenir, des mesures de fond sont nécessaires. D’une part, pour promouvoir la demande, d’autre part, pour garantir des revenus stables aux producteurs. Laure Verdeau, directrice de l’Agence Bio, souligne avec justesse ce premier axe :
« On ne peut pas décider d’imposer 18 % de surfaces en bio. Il faut qu’il y ait derrière 18 % de bio dans les assiettes des Français. Or, cette part a reculé l’an dernier de 6,4 % à 6 %, pendant que les Allemands sont à 9 %, les Suédois ou les Autrichiens à 10 %, les Danois à 12 %… »
Pour réduire cet écart, poursuit Laure Verdeau, il est essentiel de redoubler d’efforts en matière d’information et d’éducation. Il faut expliquer aux Français que le bio est bénéfique pour leur santé et pour l’environnement. Que 70 % du bio est produit en France et que les importations se composent majoritairement de produits exotiques. Que ce n’est pas nécessairement plus cher si l’on combat le gaspillage et diversifie les sources de protéines. Et qu’il existe une différence entre le logo officiel AB et la multitude de labels « verts » qui introduisent la confusion dans les esprits.
La bonne nouvelle est qu’à cette occasion, grâce à des soutiens du secrétariat général à la planification écologique, l’Agence Bio a reçu un budget significatif pour sa campagne de communication « Bio-Réflexe », à hauteur de 15 millions d’euros sur les trois années suivantes.
Cependant, les principaux moyens de promotion institutionnelle proviennent des interprofessions, comme les 20 millions d’euros annuels pour l’interprofession laitière, par exemple. Ces interprofessions, organisées par filières (lait, porc, fruits et légumes, céréales…) où dominent les producteurs conventionnels, ne souhaitent pas discuter de publicités différenciées en faveur du bio.
On touche ici un problème fondamental. Le cadre légal français interdit l’établissement d’une interprofession « bio », sous prétexte que le bio n’est pas considéré comme un produit. Chaque agriculteur bio doit donc verser une cotisation à l’interprofession correspondant à sa filière. Et même si certaines interprofessions s’engagent un peu plus que d’autres, l’investissement en faveur du bio est largement inférieur au volume des cotisations reçues de ces producteurs.
« Au Danemark, l’Etat a contraint les interprofessions de filière à communiquer sur le bio. De plus, les agriculteurs bio ont également obtenu leur interprofession bio, contrairement à ce qui se passe en France, » précise Sophia Majnoni. Cela explique pourquoi dans un supermarché danois, chaque produit a son équivalent bio et que la part de consommation bio y est le double de la nôtre. »
Un autre levier serait, comme beaucoup l’aspirent, d’imposer la loi Egalim, qui stipule que 20 % des repas servis en restauration collective doivent être bio. La moyenne nationale est péniblement de 6 %, et ce uniquement dans les cantines scolaires.
Pourtant, de nombreuses régions dépassent largement ce seuil, atteignant même 100 %, sans augmentation du « coût matière », grâce à une meilleure gestion des gaspillages et une certaine végétalisation des menus. La question est moins celle du budget de fonctionnement que de l’investissement initial en animation et en formation. Diminuer le fonds vert des collectivités locales par rapport aux engagements initiaux n’aidera pas dans cette démarche.
Établir des obligations significatives, notamment pour les grandes surfaces, les interprofessions et les collectivités : le programme Ambition bio 2027 lancé par le ministère de l’Agriculture au printemps dernier se montre hélas peu ambitieux. Et il est regrettable qu’il n’y ait aucune mention du bio par la ministre Annie Genevard lors de son discours de passation ou lors du sommet de l’élevage, comme si cette thématique n’était pas primordiale au regard des enjeux climatiques et de biodiversité.
De plus, développer la demande ne suffira pas si, en contrepartie, les producteurs nationaux ne reçoivent pas un meilleur soutien et une protection face aux fluctuations du marché. Une fois de plus, la question se pose.
« Les acteurs du bio réclament un mécanisme de gestion de crise, comme c’est le cas pour le conventionnel », note Claire Dimier-Vallet.
Étant donné que le bio n’est juridiquement pas reconnu comme une filière, il ne peut pas bénéficier des outils européens pour la régulation des marchés. Les aides d’urgence apportées par la France aux producteurs bio au cours des deux dernières années ont été autorisées à Bruxelles au titre des aides d’État exceptionnelles en lien avec le Covid et la situation en Ukraine, mais pas dans le cadre du règlement sur l’organisation commune des marchés (OCM).
Le gouvernement porte cette demande à l’échelle européenne, mais cela pourrait s’avérer être un long combat : « Nous sommes presque les seuls à solliciter une modification du règlement OCM, car dans la plupart des autres pays européens, le bio ne traverse pas de crise », déclare Sophia Majnoni. Notamment parce qu’ « il » bénéficie d’un soutien très supérieur ».
Pour la déléguée générale de la Fnab, la crise du bio a commencé en 2017, lorsque la France a choisi de supprimer les aides au maintien, contrairement à la plupart de ses voisins :
Alors que les producteurs bio, après leur période de conversion, recevaient environ 120 euros par hectare en aides au maintien plus 80 euros de paiement vert, ils ne bénéficient désormais que d’un « écorégime » de 110 euros/ha. Cela les rapproche des producteurs conventionnels qui perçoivent 80 euros/ha dans le cadre d’un écorégime s’ils sont certifiés « haute valeur environnementale », qui est en réalité à peine contraignant sur le plan écologique.
Dans ce contexte, s’engager dans le bio – et surtout y rester – n’est plus vraiment incitatif. Faire évoluer l’enveloppe des aides attribuées par Bruxelles pour réduire l’argent alloué à l’agriculture destructrice, en faveur d’une agriculture respectueuse de l’eau, des sols, des espèces et de la santé? Cela encouragerait les agriculteurs en grande culture à adopter des pratiques bio et augmenterait significativement le nombre d’hectares concernés. Ce serait dans l’intérêt de la société, mais cela risquerait de contrecarrer les intérêts de acteurs influents.
Nous avons testé des écouteurs de marques comme Sony, Bose, Apple, Marshall et Bowers & Wilkins. Découvrez les meilleurs écouteurs pour le confort et l’annulation du bruit. Et préparez-vous à faire du shopping pendant le Black Friday.

Les allocations de développement destinées aux nations les plus démunies répondent-elles réellement à leurs attentes ? Un récent rapport annuel de l’OCDE propose une réponse nuancée à cette question majeure.
En particulier concernant l’aide multilatérale, qui, contrairement à l’aide bilatérale (d’État à État), transite essentiellement par les Nations unies ou diverses banques de développement – la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou celles des Brics – chargées de les acheminer vers les pays bénéficiaires. Cette modalité d’aide représente les deux tiers du soutien au développement.
Malgré une augmentation des besoins, notamment face au changement climatique, trois tendances récentes remettent en question la capacité des donateurs à s’acquitter de leurs responsabilités auprès des pays en développement.
La première tendance est celle de la financiarisation de l’aide, favorisée par diverses réformes des modalités de financement des banques de développement mises en place depuis 2021. En raison de la stabilité des apports des pays donateurs, les banques se voient désormais encouragées à « faire plus avec des ressources financières similaires, voire moindres ».
En d’autres termes : elles ont désormais la possibilité de prêter plus avec le même montant de capital, augmentant ainsi leur « effet de levier ». Cela peut atteindre jusqu’à 30 %, permettant de générer 400 milliards de dollars d’ici 2032. Bien que ce soit une augmentation significative, elle reste inférieure aux fonds nécessaires pour réaliser les objectifs de développement durable, qui sont estimés à 750 milliards de dollars d’ici 2030.
De plus, cette financiarisation se traduit par un accroissement des prêts non concessionnels. Cela signifie qu’ils deviennent plus onéreux pour les bénéficiaires, afin d’assurer le retour sur investissement nécessaire pour ces opérations qualifiées « d’optimisation de bilan ».
« Ce problème est particulièrement préoccupant compte tenu des risques accrus associés à l’endettement des pays en développement », souligne le rapport de l’OCDE. Cela est particulièrement vrai en Afrique.
« Cette financiarisation pourrait négliger certains secteurs comme l’éducation ou le social, tout en favorisant celui des infrastructures », illustre Olivier Cattanéo, l’un des auteurs.
Bien que la financiarisation du système « a permis d’accroître la capacité de financement des banques multilatérales de développement », reconnaît l’OCDE, celle-ci « ne sera pas suffisante pour mettre en œuvre des mandats multilatéraux élargis englobant notamment la lutte contre le changement climatique, tout en maintenant les actions dans les domaines essentiels comme la réduction de la pauvreté ».
En d’autres termes, cela ne sera pas réalisable sans une augmentation parallèlement des contributions des pays donateurs.
Une autre tendance inquiétante est la part croissante des dons « fléchés » par les pays donateurs, illustrant une forme de microgestion de leur part. Contrairement aux contributions « de base » distribuées aux banques multilatérales, ces fonds fléchés sont alloués à des objectifs spécifiques, tels que des besoins humanitaires lors de crises ponctuelles, la lutte contre le Covid-19 ou, plus récemment, l’assistance à l’Ukraine.
Ces dons fléchés ont crû de plus de 400 % au cours de la dernière décennie, contre seulement 43 % pour les contributions classiques. En conséquence, ces fonds ciblés représentent désormais 49 % de l’aide multilatérale, contre 30 % il y a dix ans.
« On pourrait penser que ce fléchage est bénéfique car il permet de répondre rapidement aux crises. Cependant, certaines études montrent qu’il peut en fait retarder la réponse qui aurait été plus rapide en utilisant les fonds pluriannuels de base disponibles pour les donateurs », explique Lisa Chauvet, économiste et spécialiste du financement du développement à l’université Paris 1.
Par ailleurs, « Ils engendrent une distorsion en faveur des objectifs qui servent les intérêts des bailleurs, et vers des projets à court terme dont les résultats sont plus faciles à mesurer », ajoute la chercheuse. Ils augmentent également les coûts de gestion, de reporting, de levée de fonds, etc., pour les bailleurs. »
En revanche, les contributions de base « permettent aux organisations multilatérales la flexibilité nécessaire pour allouer des fonds en fonction de l’évolution des besoins des pays bénéficiaires », souligne l’organisation.
Enfin, le rapport souligne la fragmentation croissante de l’aide au développement, avec l’avènement de pays émergents. En tête, la Chine, suivie par des pays comme l’Inde ou l’Arabie saoudite.
À noter : « Ces nouveaux donateurs offrent une bien plus grande latitude aux organisations multilatérales, en se servant moins de contributions fléchées », observe Olivier Cattanéo.
Cependant, la multiplicité des donateurs soulève plusieurs défis pour l’architecture mondiale du développement, ce qui implique, par exemple, une révision du cadre de restructuration des dettes des pays bénéficiaires, dont les nouveaux donateurs ne font pas partie pour le moment.
En opposition à ces défis, le gouvernement français a décidé, après plusieurs années d’augmentation, de réduire son budget d’aide au développement : celui-ci a été diminué de 1,3 milliard d’euros dans son projet de loi de finances pour 2025.
Diffusez en direct Philadelphia 76ers contre Memphis Grizzlies dans la NBA gratuitement depuis n’importe où dans le monde.
C’est le chapitre final de la bromance entre Microsoft et OpenAI ! Découvrez les coulisses de cette séparation entre deux titans technologiques et quelles en seront les répercussions dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Microsoft et OpenAI ont été des pionniers dans le monde de l’IA pendant de nombreuses années en raison de leur collaboration. Ce partenariat a permis à OpenAI de développer des outils IA novateurs comme ChatGPT. De son côté, cela a propulsé Microsoft vers des niveaux de revenus exceptionnels.
En effet, après avoir injecté un milliard de dollars dans OpenAI, le géant technologique a rapidement observé son investissement dépasser les 13 milliards de dollars. Cependant, cette alliance autrefois robuste a commencé à se fissurer. Entre luttes de pouvoir stratégiques et ambitions différentes, il n’est pas surprenant de se demander pourquoi Microsoft et OpenAI ont décidé de mettre un terme à leur coopération? La réponse se trouve dans les paragraphes suivants !

Alors que l’IA devient un atout majeur pour les entreprises, Microsoft et OpenAI se retrouvent en compétition frontale pour s’imposer sur le marché. Il convient de noter qu’OpenAI a essayé d’attirer des entreprises vers sa version professionnelle de ChatGPT, au lieu de les diriger vers les offres Copilot de Microsoft.
Cette approche a provoqué la colère de Microsoft, qui y voit une tentative d’OpenAI de se libérer de son emprise. Satya Nadella, le PDG de Microsoft, a même affirmé : « Si OpenAI venait à disparaître demain, nous avons tout ce qu’il nous faut pour avancer seuls ». Malgré cette tension, les deux parties ont continué à donner l’impression de collaborer, du moins en apparence.


La principale raison des discordes entre Microsoft et OpenAI réside principalement dans la gestion des ressources technologiques, en plus de la concurrence pour attirer un maximum de clients. OpenAI requiert une quantité énorme de puissance de traitement pour faire fonctionner ses modèles d’intelligence artificielle, et bien que Microsoft en fournisse une grande part, OpenAI considère cela comme encore insuffisant pour répondre à ses aspirations.
OpenAI a même établi un accord avec Oracle pour accroître sa capacité informatique, interprété comme un signal de rupture significatif avec Microsoft. Cette décision n’a fait qu’exacerber les tensions. En réaction à ce geste, Microsoft a commencé à diversifier ses ressources en matière d’IA, en recrutant des talents de la société concurrente, Inflection.
Le partenariat commercial entre Microsoft et OpenAI a débuté avec GitHub, alors leur divorce commence-t-il à partir de là ? https://t.co/MXNpEyp64C
— Gennaro (@gennarocuofano) October 29, 2024
Je m’attends à ce que la conclusion de ces conflits entre Microsoft et OpenAI se fasse devant les tribunaux. OpenAI, qui était autrefois une organisation à but non lucratif, a évolué vers une entreprise à objectif lucratif, ce qui complique les questions entourant la valorisation de l’investissement de Microsoft. Pour clarifier cette situation, les deux géants se sont tournés vers des banques d’investissement, exacerbant ainsi le conflit.
Malgré l’évaluation d’OpenAI à 157 milliards de dollars, Microsoft, avec ses 3 190 milliards de dollars, a les ressources pour engager un combat judiciaire et défendre ses intérêts, annonçant ainsi une lutte acharnée.
Alors que les tensions entre les deux entreprises continuent de croître, il est évident que Microsoft et OpenAI pourraient transformer l’ensemble du paysage de l’intelligence artificielle. La bataille pour la suprématie dans ce domaine est lancée, et seul le temps éclairera lequel des deux géants sortira victorieux de ce défi technologique.
Please active sidebar widget or disable it from theme option.
{{ excerpt | truncatewords: 55 }}
{% endif %}